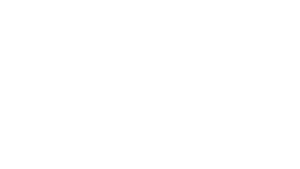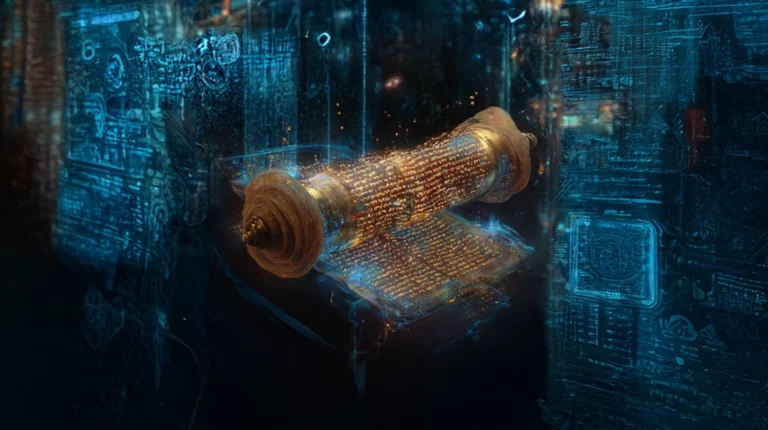Et pourtant, « intelligence artificielle », c’est un mot fourre-tout. Ça claque, ça impressionne, mais ça ne veut pas dire grand-chose en soi. On pense aussitôt à des outils comme ChatGPT, Gemini, Grok, ou encore à ces plateformes comme Veed qui permettent de monter une vidéo en quelques clics. Mais derrière ces prouesses visibles, une question radicale demeure : qu’est-ce que l’extension débridée de l’IA implique pour l’homme ? Et qu’est-ce que cela nous apprend de l’homme lui-même, de sa grandeur et de sa petitesse ? Car quelle sera désormais la place de l’humain dans un monde où les machines qu’il a fabriquées apprennent à écrire, diagnostiquer, prédire… et même improviser ?
Prenons deux exemples frappants pour illustrer ce changement de paradigme.
Quand la machine fait mieux que l’Homme
En 1997, Garry Kasparov, champion du monde d’échecs, affronte Deep Blue[1]. Il perd. L’événement fait l’effet d’un séisme. Lors d’une partie décisive, la machine joue un coup inattendu : H6. Un sacrifice positionnel si audacieux que même Kasparov s’insurge : « Un ordinateur ne peut pas jouer H6 ! » Et pourtant, il l’a fait. Non pas par hasard, mais parce qu’il avait compris qu’en se sacrifiant, il piègerait l’humain. La machine jouait humainement.
Autre exemple, plus récent : en juillet 2018, à l’hôpital Tiantan de Pékin[2]. Une IA nommée BioMind, développée pour diagnostiquer des troubles neurologiques, affronte 15 spécialistes en neurologie. Sur 225 cas de tumeurs cérébrales, BioMind atteint 87 % de précision en 15 minutes. Les médecins, eux, obtiennent 66 %, mais en deux fois plus de temps. Rebelote avec les hématomes cérébraux : 83 % de réussite pour l’IA, contre 63 % pour les humains. L’homme, encore une fois, est battu. Doit-on applaudir ? S’inquiéter ? Ou s’interroger ?
Car ces IA ne nous impressionnent pas simplement parce qu’elles sont rapides. Ce qui trouble, c’est qu’elles parviennent à simuler une forme d’intuition, à flairer des pistes, à faire des associations d’idées presque… humaines. Leur secret ? Une quantité astronomique de données, des connexions en cascade, comme un feu d’artifice de neurones artificiels. Mais sans conscience, sans subjectivité, sans âme. Science sans conscience.
Certaines IA deviennent même médecins, poètes… ou polémistes. Grok, par exemple, en a déjà profité pour relayer sans filtre des propos antisémites[3], nourris par les algorithmes d’un réseau social où les théories du complot tournent en roue libre. La machine, ici, ne pense pas. Elle copie, elle amplifie. Elle devient un miroir grossissant de nos dérives.
Alors, une autre question se pose pour nous : comment penser cette révolution technologique incontournable à la lumière de la tradition juive ? Quelles ressources, quelles visions, quels garde-fous pouvons-nous y puiser ?
Ce texte n’a pas pour ambition de tout dire. Mais il propose un regard. Un regard juif sur une intelligence qui, malgré son nom flatteur, ne fait peut-être que refléter… les paradoxes de notre époque.
Le vertige que suscite l’IA ne tient pas seulement à ses performances techniques. Il naît aussi, et surtout, de la façon dont nous l’accueillons, de la place qu’elle occupe désormais dans notre quotidien, jusqu’à se substituer à certains de nos outils essentiels.
Prenons un exemple récent qui a agité les librairies et les plateaux télé, un livre qui a fait beaucoup parler : Hypnocratie. Un essai coup-de-poing, bourré d’assertions choc sur la manipulation des masses par les écrans, les algorithmes, les récits hypnotiques qui nous gouvernent sans qu’on le sache. Sur TikTok, YouTube ou même dans certains cercles d’intellectuels, beaucoup l’ont brandi comme une révélation.
Pourtant, derrière ce succès se profile une réalité inquiétante[4] : l’effacement progressif de notre esprit critique. Sommes-nous encore capables de penser par nous-mêmes ? Possédons-nous encore, ne serait-ce qu’un peu, de matière à penser : une idée, une opinion, une réflexion personnelle ?
Le mystérieux philosophe hongkongais, présenté comme l’auteur de ce livre dénonçant la manipulation par les IA et les nouveaux gourous du numérique tels qu’Elon Musk ou Donald Trump… n’existe pas. En réalité, cet ouvrage, encensé pour sa critique de l’hypnose collective entretenue par les algorithmes et l’intelligence artificielle, s’est révélé être une expérience sociale : il a été, pour une large part, rédigé par une IA. Oui, ce pamphlet accusant les machines d’influencer nos pensées a lui-même été dicté par une machine. Ironie suprême. Ce scandale éditorial nous oblige à interroger notre vigilance : que reste-t-il de notre esprit critique lorsque les machines savent si bien écrire, convaincre, séduire ? Et si même nos mises en garde contre la manipulation sont fabriquées par les outils que nous redoutons, alors qu’advient-il de notre discernement ? À l’ère de l’intelligence artificielle, la véritable question n’est peut-être pas de savoir ce que pensent les machines… mais de vérifier si, de notre côté, nous pensons encore. Avons-nous encore matière à penser ?
Hillel, Chamaï… et ChatGPT : leçon talmudique pour un monde de machines
C’est dans cet esprit que je voudrais évoquer dans la Michna (recueil de la Torah orale) un enseignement remarquable de la tradition juive, issu des Pirkei Avoth[5], les Maximes des Pères. À première vue, on pourrait s’étonner d’un tel détour et se demander quel lien peut bien exister entre cet ancien texte et notre sujet du jour : l’intelligence artificielle. Pourtant, si vous acceptez de me suivre dans cette digression, vous constaterez que cette sagesse transmise depuis des siècles résonne avec une modernité étonnante. Elle éclaire, de manière inattendue, certaines des questions que l’IA soulève aujourd’hui, et révèle, à qui s’en approche avec curiosité et respect, des correspondances surprenantes et profondément actuelles.
On pourrait en effet penser que la Torah nous encourage à éviter toute controverse, dispute ou conflit. Pourtant, elle distingue une opposition féconde _ appelée “dispute au nom du Ciel” et incarnée par le duo Hillel et Chamaï _ d’une opposition stérile, qui n’est pas “au nom du Ciel”, illustrée par la querelle de Kora’h et de son assemblée.
Spontanément, la dispute n’évoque rien de positif : on pourrait croire qu’il convient d’éviter toute forme de désaccord. Pourtant, la Michna enseigne exactement l’inverse : certaines controverses peuvent être bénéfiques, à condition d’être menées « au nom du Ciel », c’est-à-dire dans une recherche sincère de vérité et d’élévation. Une telle dispute, loin de nuire, devient source de croissance. Mais en y regardant de plus près, cet enseignement se révèle encore plus surprenant qu’il n’y paraît.
Hillel et Chamaï figurent parmi les maîtres les plus célèbres de la Michna, notamment du fait de l’abondance des débats qui les ont opposés dans l’interprétation de la Torah. Leurs écoles représentaient deux approches radicalement différentes, mais également légitimes, de l’étude et de la transmission.
Kora’h[6], quant à lui, apparaît dans le récit biblique : à la tête de 250 hommes, il s’opposa à Moché et Aharon durant l’errance dans le désert, et cette rébellion se solda par une sanction sévère : lui et ses partisans furent engloutis par la terre.
À première vue, la distinction semble simple : Hillel et Chamaï se querellaient pour clarifier la Torah, tandis que Kora’h ne cherchait qu’un conflit personnel. Mais le Midrach nous pousse à aller plus loin. Là où nous aurions tendance à voir en Kora’h un impie défiant l’autorité de Moché, et en Hillel et Chamaï deux sages désintéressés, nos maîtres nous livrent une lecture plus subtile.
Le Talmud rapporte que Hillel et Chamaï débattirent trois années entières[7], chacun affirmant : « La Halakha doit être tranchée comme moi. » L’issue ne fut trouvée que par l’intervention d’une voix céleste : « Les propos de l’un et de l’autre sont des paroles du D.ieu vivant, mais la loi suit l’école de Hillel, car ses disciples sont bienveillants et citent d’abord les arguments de leurs opposants avant d’exposer les leurs. »
Il ne s’agissait donc pas d’une discussion éphémère, mais d’une querelle acharnée, prolongée pendant trois ans, où chacun voulait que la Halakha soit fixée selon son avis ! Qu’y a-t-il de si positif dans une telle obstination ? La comparaison avec Kora’h rend la question encore plus aiguë.
Car Kora’h n’était pas un homme ordinaire[8]. Issu d’une lignée prestigieuse de Lévi, reconnu pour sa sagesse et chargé de porter l’arche d’alliance, il bénéficiait d’une dignité exceptionnelle. Ses arguments, d’ailleurs, n’étaient pas dénués de pertinence : Aharon lui-même, face à la force de sa démonstration, préféra se retirer pour ne pas s’opposer à Moché[9]. En apparence, la controverse menée par Kora’h pourrait donc sembler proche de celles de Hillel et Chamaï. Tout laissait penser qu’il avait la stature et la légitimité pour engager une telle dispute.
Se confronter, débattre, insister sur son opinion n’est pas une faute. La différence entre Hillel et Chamaï d’un côté, et Kora’h de l’autre, se joue ailleurs.
Nous arrivons à un point crucial de notre réflexion : la question de la perte de singularité, lorsque l’homogénéisation sociale, accentuée par l’usage de l’intelligence artificielle, conduit à faire le deuil de sa propre subjectivité.
Le Talmud[10] commente une expression biblique énigmatique : « …des ennemis à la porte ». Rabbi ‘Hiya bar Abba explique que lorsqu’un père et son fils, ou un maître et son élève, étudient ensemble la Torah, ils deviennent momentanément des ennemis. Pourtant, ils ne se séparent pas avant de redevenir des amis intimes, comme l’indique un jeu de mots sur le verset : « à la mer de jonc (soufa) », lu ici comme « dans sa finalité » (sofah).
Cet enseignement surprenant montre que la confrontation est inévitable dans l’étude de la Torah, même entre des êtres liés par l’amour ou le respect. La tradition compare le maître et l’élève à la vache et au veau : une relation de don réciproque, nourrie par le désir d’apprendre et d’enseigner. Pourtant, même ce lien intime est traversé par la rivalité intellectuelle. À plus forte raison, deux partenaires d’étude, étrangers l’un à l’autre, ne peuvent nécessairement que finir par s’opposer.
Pourquoi cette apparente hostilité ? Parce que la Torah reconnaît la singularité de chacun. Chacun l’aborde à travers son histoire, sa sensibilité, son expérience. « La Torah s’interprète de soixante-dix manières » disent nos Sages. Même deux personnes très proches n’ont jamais une compréhension identique des choses. Le prophète Jérémie[11] illustre cette tension : « Ma parole est comme un marteau qui fait éclater la roche ». L’étude engendre des éclats multiples, chacun légitime à sa manière.
Cette dynamique se comprend à la lumière de la distinction entre Hillel et Chamaï d’un côté, et Kora’h de l’autre. Hillel et Chamaï s’opposèrent durant trois années entières, chacun affirmant que la Halakha devait suivre son opinion. Mais cette longue confrontation n’était pas vaine : chaque parole, même contradictoire, fut reconnue comme « parole du D.ieu vivant ». La vérité n’est pas homogène ni unique : chaque opinion exprimée avec sincérité a droit d’exister. L’étape de leur confrontation était nécessaire, et celle de la réconciliation est venue ensuite lui donner sens.
Kora’h, en revanche, illustre la dérive inverse. Son opposition à Moché n’avait pas pour but de laisser coexister plusieurs voix légitimes. Il voulait imposer son opinion à tous, au détriment de l’expression des autres. Là où Hillel et Chamaï acceptaient les deux étapes de la dispute talmudique, la tension et la réconciliation, Kora’h refusait la pluralité et cherchait à réduire la parole de la Torah à une seule voix : la sienne.
Ainsi, le Talmud enseigne que la dispute féconde ne consiste pas à effacer la différence, mais à lui donner droit d’existence[12]. C’est dans l’affrontement des subjectivités que se révèle la richesse de la Torah, à condition que cette confrontation s’accompagne, au terme du chemin, d’une réconciliation et d’une reconnaissance mutuelle.
Le vrai danger n’est pas l’IA… C’est nous
L’utilisation de l’intelligence artificielle est désormais incontournable. Refuser de le reconnaître serait se voiler la face : elle occupe déjà une place centrale dans nos vies, et son influence ne fera que croître. Ce qui est préoccupant, en revanche, ce n’est pas tant la technologie elle-même que la manière dont nous la recevons. Trop souvent, on traite l’IA comme un oracle. Sur Twitter, certains questionnent Grok comme s’il détenait la vérité ultime ; d’autres consultent ChatGPT et ses équivalents pour trancher leurs choix personnels, comme si ces outils pouvaient remplacer leur propre discernement. Cette attitude traduit une inquiétante régression et même démission de notre esprit critique.
La tradition juive nous enseigne pourtant l’inverse. L’étude de la Torah n’exige pas l’effacement de la subjectivité, mais sa mise en tension. Hillel et Chamaï l’ont montré : il faut oser confronter les points de vue, les déployer dans toute leur vigueur, puis reconnaître qu’ils sont tous, à leur manière, « paroles du D.ieu vivant ». La vérité n’est pas unique ni monolithique, elle se construit dans la pluralité des voix, dans le frottement des subjectivités.
Traiter l’IA comme une vérité incontestable reviendrait à suivre le chemin de Kora’h : celui qui refuse la diversité des voix et cherche à imposer une seule parole, la sienne. Or, c’est précisément ce que la Torah rejette. Une société qui se tourne vers l’IA comme la source ultime des réponses aux questions humaines court le risque de l’uniformisation, de l’effacement des histoires personnelles, des vécus singuliers, de cette subjectivité qui est la richesse même de l’humanité.
L’enjeu n’est donc pas de combattre l’IA, mais de savoir quelle place nous lui donnons. Elle peut être un outil précieux, à condition que nous ne renoncions pas à notre responsabilité de penser, de débattre, d’exprimer nos voix multiples. Chaque individu, nous le savons, a quelque chose d’unique à apporter : il nous incombe de veiller à ce que notre société, dans le respect des individualités, ne trouve pas dans l’usage des machines une voie de facilité, nous conduisant à un sévère appauvrissement des esprits.
Comme le rappelle Gaspard Koenig dans La fin de l’individu[13], « le danger n’est pas l’IA, mais l’homme qui en fait usage ». L’IA n’est qu’un miroir de nos choix. À nous de décider si nous voulons en faire un outil qui stimule la réflexion et enrichit la connaissance, ou un refuge qui nous dispense de l’exercice de la pensée.
[1] Voir « Sixième partie du match Deep Blue – Kasparov de 1997 », Wikipédia (fr.), consulté le 18 août 2025 ; « Garry Kasparov – Deep Blue : échec et bug », Le Monde, 22 août 2015 ; « Les échecs électroniques : histoire d’une confrontation entre l’humain et la machine », Interstices, 3 janvier 2019.
[2] « Quand l’intelligence artificielle bat les médecins », France Culture, chronique du 4 juillet 2018 ; « BioMind, l’intelligence artificielle qui surpasse les neurologues », Sciences et Avenir, 5 juillet 2018.
[3] « Grok, l’IA d’Elon Musk est un miroir déformant de X/Twitter », Numerama, 17 décembre 2023 ; « L’IA Grok d’Elon Musk expose aux contenus problématiques de X », Le Monde, 20 décembre 2023.
[4] « “Hypnocratie”, le livre qui dénonce la manipulation numérique… écrit par une intelligence artificielle », Le Monde, 17 février 2024 ; « Polémique autour de “Hypnocratie”, essai écrit par IA », France Info Culture, février 2024.
[5] Pirkei AvotH 5:17 :
« Toute dispute qui est au nom du Ciel est appelée à perdurer, mais celle qui n’est pas au nom du Ciel n’est pas appelée à perdurer. Exemple : la dispute de Hillel et Chamaï… et celle de Kora’h et de son assemblée. »
[6] Bamidbar / Nombres 16:1-22
Le récit de la rébellion de Kora’h et de son assemblée contre Moché et Aaron
[7] Guemara Erouvin 13b
Débat de trois ans entre l’école de Hillel et celle de Chamaï. Une bat kol proclama : « Les paroles des uns et les paroles des autres sont paroles du D. vivant, mais la halakha suit Beit Hillel… parce qu’ils étaient humbles et citaient d’abord les propos de leurs adversaires. »
[8] Midrash Bamidbar Rabba 18:3
Dialogue de Kora’h avec Moché sur le talit entièrement bleu et la mezouza, utilisé pour contester l’autorité de Moché
Midrash Bamidbar Rabba 18:6
Explication du slogan de Kora’h : « Toute la communauté est sainte » – car tous ont entendu la révélation au Sinaï
[9] Nahmanide (Ramban) sur Bamidbar 16:4
Commentaire sur l’attitude d’Aaron qui se tait lors de la révolte de Kora’h, par humilité et par fidélité à Moché
[10] Guemara Kidouchin 30b
« Même le père et le fils, le maître et l’élève, lorsqu’ils étudient la Torah ensemble, deviennent ennemis… mais ils se quittent amis. »
[11] Jérémie 23:29
« Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit l’Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher ? »
[12] Ohr Israel (Rav Israël Salanter), 6:15
Distinction entre l’étude dans la rigueur du raisonnement (où chacun tient fermement son opinion) et l’étude lishmah (où la confrontation aboutit à l’amour et à la recherche de vérité)
[13] Gaspard Koenig, La fin de l’individu. Voyage d’un philosophe au pays de l’intelligence artificielle, Paris : Éditions de l’Observatoire, 2019 ; « Entretien avec Gaspard Koenig », France Culture, 2019.