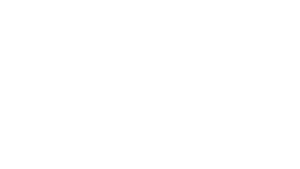À la lecture, on a d’ailleurs l’impression qu’il appartient à une époque révolue. Les titres des chapitres à eux seuls en disent long, ainsi : « La sexualité est une chose sérieuse », « Les hommes et les femmes sont différents », « La valeur de la retenue », sans parler de « Le mariage a du bon ». On dirait un livre qui aurait pu être écrit par nos grand-mères. Et pourtant, l’auteur n’a rien de commun avec une grand-mère. Elle a grandi avec des convictions qui n’ont absolument rien à voir avec celles qu’elle expose aujourd’hui. Il a fallu qu’après son diplôme de fin d’études elle se mette à travailler dans un centre d’accueil pour victimes de viol pour commencer à mettre en question les idées reçues propagées par la culture laïque contemporaine sur la vie intime d’une femme. Le livre en question est le résultat de cette réflexion.
En prenant un certain recul pour examiner à fond les modifications sociales que la révolution des mœurs a provoquées, elle pose la question globale : « Était-ce une bonne chose pour les femmes ? »
La remise en question
Comme l’explique Louise Perry dans son livre, l’apparition de la pilule a très rapidement mené à un effondrement des tabous qui avaient prévalu jusqu’alors concernant la sexualité prémaritale. Maintenant que la femme pouvait contrôler sa fertilité, on s’est dit qu’elle pouvait se libérer du joug du mariage et de la maternité, qui avaient de tous temps été utilisés pour la dominer et la confiner aux tâches ménagères.
Naturellement, elle reconnaît qu’il y a là une certaine vérité, mais elle avance l’idée que l’alternative, à savoir une culture prônant la promiscuité, le consentement mutuel étant tout ce qui est requis, loin de faire progresser les droits de la femme, a eu l’effet exactement contraire. C’est la thèse qu’elle défend tout au long de son livre, avec force détails.
L’auteur ne défend aucune thèse religieuse et se place d’un point de vue uniquement laïque, même s’il lui arrive de mentionner la religion au passage en décrivant son influence dans le domaine du mariage et des mœurs. Et pourtant, les conclusions auxquelles elle parvient sont tout à fait compatibles avec la sagesse du judaïsme. C’est ce rapprochement que nous allons explorer en examinant quelques points essentiels qu’elle met en lumière.
La sexualité est une chose sérieuse
Pour l’auteur, le désenchantement sexuel, l’idée qu’une relation n’a rien de particulièrement spécial ni puissant, est tout simplement une convention mensongère. La plupart des gens savent instinctivement que l’intimité physique n’est pas la même chose que de, par exemple, faire un café à quelqu’un. Elle cite plusieurs femmes qui n’ont pas été violées, mais qui se sont senties profanées et n’arrivaient pas à comprendre leurs propres sentiments, bien qu’ayant techniquement consenti à un rapport.
En tant que journaliste, Louise Perry avait milité pour défendre les droits de la femme, en mettant l’accent sur les violences sexuelles, notamment grâce à son passage dans un centre d’aide aux victimes de viol, qui l’a confrontée à certaines des pires épreuves qu’une femme puisse subir. Et pourtant, elle souligne que ce n’est pas seulement dans ce genre de cas extrême que les femmes sont perdantes. Il y a aussi la pression sociale omniprésente qui leur souffle de ne tenir aucun compte de leur instinct (par exemple, elle sent parfaitement qu’il vaut mieux ne pas rentrer chez soi avec un homme ivre, de forte carrure et musclé, que l’on connaît à peine) et les pousse à jouer le rôle qu’on attend d’elles.
Pour le judaïsme, l’intimité physique est l’une des choses les plus saintes qui soient, et comme toute chose sainte et précieuse, elle est entourée de barrières et d’encadrements, ce qui confirme notre intuition qu’il s’agit d’une chose grave et sérieuse.
L’intimité sans amour n’a rien de valorisant
Lorsque la contraception a donné aux femmes plus de maîtrise de leur fertilité, cela a rapidement mené à une culture basée uniquement sur le consentement. La nouvelle femme moderne et libérée semblait incarner une participation sans réserve aux relations éphémères. Et pourtant ! Certes, l’auteur souhaite ardemment que les femmes puissent mieux dominer leur vie, mais elle fait remarquer que lorsque les normes de la société n’exigent plus des hommes ni maturité ni engagement, ce sont elles qui sont perdantes.
En moyenne, les hommes vivent leur sexualité de façon plus libre et plus détachée que la plupart des femmes (« il faut bien profiter de la vie »). Il y a bien entendu des exceptions, mais la femme moyenne qui se prête au modèle moderne des rencontres passagères ne fait pas ce qu’elle voudrait spontanément, mais plutôt ce qui convient le mieux aux hommes.
Selon la journaliste, la culture dans laquelle nous vivons[1] non seulement encourage la promiscuité, mais fait une telle pression sur les femmes qu’elles finissent par s’imaginer que c’est ce qu’elles souhaitent, elles aussi. Se tracer des limites quant à l’intimité est considéré comme prude, bizarre, ou réservé aux gens très religieux, et non comme la réaction raisonnable de quelqu’un qui porte la responsabilité d’une éventuelle grossesse, qui est beaucoup plus susceptible d’être la victime de violences conjugales ou sexuelles, et qui statistiquement a beaucoup moins de chances de trouver agréables ce genre de rencontres sans lendemain.
Aujourd’hui, les femmes doivent se justifier de préférer attendre
La pression sociale est une force qu’on ne peut pas ignorer. Dans la culture d’aujourd’hui, et particulièrement sur les campus, les femmes se trouvent dans la position délicate de devoir se justifier si elles ne souhaitent pas de relations intimes. Et dans un monde où les aventures d’un soir sont la norme, une femme qui préférerait une relation plus stable est consciente que son attitude va réduire ses chances de trouver un partenaire.
Demandons-nous à présent comment cela se passe dans le monde juif traditionnel. Lorsque deux personnes, se sentant prêtes pour le mariage, envisagent de se rencontrer, elles commencent par se demander clairement ce qu’elles recherchent chez un(e) partenaire, et c’est seulement lorsqu’elles se sont assurées que leurs critères essentiels sont réunis qu’une rencontre face à face peut avoir lieu.
Bien évidemment, ce système repose surtout sur la culture, mais chacun peut aussi en tirer des enseignements pour lui-même. Les femmes peuvent et doivent se demander : « Est-ce quelqu’un que je pourrais envisager d’épouser ? Et dans le cas contraire, est-ce que je souhaite vraiment une relation physique ou est-ce que je ressens simplement que c’est ce qu’on attend de moi ? »
Le mariage a du bon
Sociologiquement parlant, c’est exactement l’institution du mariage monogame, que les féministes considéraient comme étant ce qu’il y a de plus contraignant pour les femmes, qui s’avère être la meilleure solution pour elles. Les femmes qui se trouvaient enfermées dans des mariages très difficiles ou même dangereux en ont été libérées à juste titre par un accès de plus en plus facile au divorce. Mais paradoxalement, il s’en est suivi une vague de divorces, alors que les mariages incriminés n’étaient pas aussi dramatiques qu’on le disait. Aujourd’hui, à moins que le mariage ne débouche sur un épanouissement complet (ce qui n’est pas si facile pour une génération pressée qui n’a même pas le temps d’une rencontre hebdomadaire), la relation est entièrement remise en question. Et bien que le taux des divorces ait commencé à diminuer, ne nous réjouissons pas trop vite : c’est uniquement parce qu’il est tout simplement de plus en plus rare de se marier.
Et pourtant le mariage, du point de vue social, est régulièrement associé à une plus grande réussite pour toute la communauté. L’effritement du mariage ne profite pas aux femmes, essentiellement parce qu’il ne profite à personne.
Louise Perry décrit en outre le phénomène surprenant de l’augmentation phénoménale du nombre de mères célibataires depuis l’arrivée de la pilule (elle explique que sa fiabilité à 91% donne un faux sens de sécurité qui mène à une hausse spectaculaire des grossesses non désirées). Elle mentionne également que lorsque les mères sont très proches de leurs enfants, cela représente pour eux un grand avantage. Or ce n’est naturellement possible que lorsque les deux parents peuvent partager la charge des revenus et de l’éducation des enfants. D’après elle, lorsque les normes sociales encourageaient le mariage pour les hommes, les femmes étaient particulièrement gagnantes, car cela obligeait les hommes à développer la responsabilité et la maîtrise de soi nécessaires pour jouer ce rôle. Dans une interview récente, elle explique : « Le problème du culte de la liberté actuel est qu’il encourage les hommes à se montrer sous leur pire jour. » Les hommes n’ont pas envie de devenir des « papas modèles », parce qu’ils n’ont plus aucune raison de le faire.
On doit malheureusement ajouter que la mère célibataire n’est pas la seule à subir les conséquences éventuelles d’une aventure passagère. Les taux officiels d’avortement, y compris de femmes mariées, sont en effet très élevés : 15,4% pour l’année 2024 aux Etats-Unis, 16,8% pour la France. Or cette épreuve (qui est aussi en soi atteinte à la vie) peut fragiliser la femme, à la fois physiquement et émotionnellement.
La législation du judaïsme à cet égard est assez complexe. Pour simplifier, la loi juive donne la priorité à la mère sur l’enfant, et dans les cas où la vie de la mère est en danger, le bébé doit lui céder la place. Il y a d’autres cas très spécifiques dans lesquels une interdiction de grossesse sera émise, mais une chose est claire : en aucun cas il ne peut y avoir d’autorisation de simple convenance.
Par-dessus tout, ce livre propose au lecteur une occasion de remettre en cause le statu quo. Les normes avec lesquelles nous avons grandi doivent être réévaluées d’un œil critique. Et bien que la société ait un impact considérable sur nos vies, chacun de nous a le droit d’avoir une opinion sur la façon dont il souhaite vivre.
Adapté de l’article Aish.com avec l’aimable autorisation de Aish.
[1] N.d.t. : Cette culture de la promiscuité semble être la norme en Amérique, beaucoup plus en tous cas qu’en France ou en Israël, où même si les mœurs sont plus relâchées qu’autrefois, il reste un certain respect pour les valeurs traditionnelles.