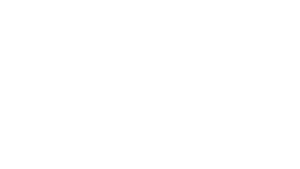J’ai grandi dans une famille où la Shoah n’était pas un souvenir lointain, mais une présence diffuse — dans les silences, les habitudes, les peurs du quotidien. La mémoire façonnait notre identité. Et aujourd’hui, en plein cœur du deuil du 9 Av, une question me revient : à force de pleurer les tragédies passées, ne risquons-nous pas de faire de notre deuil une forme de dolorisme normatif ?
Notre attachement au Temple détruit est-il encore vivant, ou figé dans une répétition rituelle qui nous empêche d’avancer ? Peut-on transformer la mémoire en culte sans s’enfermer dans l’immobilité ?
Cela interroge d’autant plus que le judaïsme place la joie au cœur du service divin : « Parce que tu n’as pas servi l’Éternel ton D.ieu avec joie… » (Devarim/Deutéronome 28:47). La simple observance ne suffit pas — elle doit être portée par une joie authentique. Pourquoi alors, chaque année, choisissons-nous d’entrer volontairement dans la tristesse de Ticha’ be-Av ? Pourquoi raviver un deuil ancien, comme s’il venait d’avoir lieu ?
Il y a dans le Talmud un passage saisissant qui touche directement à cette question. C’est de là que la Halakha tire les lois du deuil. Rav Yéhouda enseigne au nom de Rav : « Celui qui se lamente au-delà de la mesure sur un mort, finira par pleurer un autre mort. » Il raconte l’histoire d’une femme du quartier de Rav Houna qui perdit un de ses sept fils. Elle se lamentait sans discontinuer. Rav Houna l’avertit en vain qu’un tel deuil excessif était dangereux. Elle refusa de l’écouter et l’impensable arriva : elle perdit tous ses enfants, puis sa propre vie. Le message du Talmud est terrible, presque brutal. Trop de deuil tue la vie. Se figer dans la perte peut conduire à ne plus voir ce qui reste vivant autour de soi. La douleur devient alors stérile, destructrice. Rav Houna, en l’avertissant, ne cherche pas à nier sa souffrance, mais à la remettre dans une perspective où la vie, malgré tout, doit continuer. En se focalisant sur la mort, elle perd la capacité de vivre.
Et pourtant, paradoxalement, le même Talmud nous enseigne que nous avons le devoir de pleurer Jérusalem, année après année. Il est dit :
« Quiconque accomplit un travail le 9 Av et ne s’endeuille pas sur Jérusalem ne verra pas sa consolation, comme il est écrit : ‘Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez avec elle, vous tous qui l’aimez ; réjouissez-vous avec elle, vous tous qui êtes en deuil à son sujet.’ »
De là, nos Sages concluent : « Celui qui s’endeuille sur Jérusalem, mérite et la voit dans sa joie, et celui qui ne s’endeuille pas, ne la voie pas dans sa joie. »
Comment comprendre ce paradoxe ? D’un côté, on nous met en garde contre un deuil excessif, destructeur. De l’autre, on nous demande de nous replonger chaque année dans la peine, de raviver une douleur ancienne. Pourquoi ce double discours ? Quel message la tradition veut-elle nous transmettre à travers cette tension apparente entre mémoire et vie, entre deuil et joie ?
Fêter la destruction ? Le paradoxe du 9 Av
Le paradoxe du 9 Av est plus profond qu’il n’y paraît. Il révèle peut-être que nous comprenons mal cette journée pourtant centrale dans le calendrier juif. C’est ce que je souhaite éclairer ici, à travers une série de détails souvent négligés, mais révélateurs d’une complexité — voire d’une contradiction — qui entoure cette date.
Dans la tradition juive, certains éléments rituels expriment la nature d’un jour. Les Ta’hanounim (supplications de repentance récitées quotidiennement), par exemple, disparaissent dès qu’une certaine joie est présente — lors des fêtes, ou à Roch ‘Hodech (premier jour du mois) ou encore lorsqu’un marié ou un père de Berith Mila se trouvent dans l’assemblée. Pourtant, le 9 Av, jour de deuil intense, on ne récite pas. Ce n’est ni un oubli ni une exception : c’est une décision codifiée. Plus étonnant encore, le rouleau de Eikha / Les Lamentations que nous lisons ce jour-là désigne le 9 Av comme un Mo’ed, un terme biblique qui évoque le “rendez-vous” de la fête : « Il a proclamé un Mo’ed contre moi pour briser mes jeunes hommes » (Eikha 1:15). Le jour même de la plus grande tragédie de notre histoire est ainsi qualifié de “rendez-vous” solennel. Pourquoi la destruction serait-elle donc décrite comme une “rencontre“ ? Pourquoi le deuil prend-il une forme quasi festive ? Ce paradoxe n’est pas anodin : il nous invite à repenser en profondeur notre rapport au 9 Av — et au deuil en général.
Un autre élément accentue cette tension : six jours après Ticha’ be-Av, le 15 Av (Tou be-Av) est présenté par la Michna comme l’un des jours les plus joyeux de l’année, au même titre que Yom Kippour. Ce jour-là, les jeunes filles dansaient dans les vignes, vêtues de blanc, proclamant : « Ne regarde pas la beauté, regarde la lignée… » Un véritable rituel d’union et d’espoir. En moins d’une semaine, on passe du deuil aux danses, du silence à la joie. Comment expliquer un tel basculement ?
Mais c’est peut-être le lendemain du 9 Av qui est le plus troublant. Pendant trois semaines, les restrictions s’intensifient en préparation au jeûne : on évite les mariages, la musique, la viande… puis, subitement, tout s’arrête dès le 10 Av à midi. On se lave, on mange, on reprend la vie comme si de rien n’était. Pourtant, selon Rabbi Yo’hanan, c’est le 10 Av que l’essentiel de l’incendie du Temple s’est produit : « Si j’avais été présent, j’aurais fixé le jeûne le 10 Av. » Et malgré cela, dès le lendemain du jeûne, on allège les lois de deuil. Ce décalage entre la réalité historique — où le feu ravageait encore le Temple — et la liturgie qui reprend son cours, interroge : avons-nous vraiment pris la mesure de ce que nous pleurons ?
Au fond, trois grandes questions émergent. D’abord, comment expliquer l’instauration d’un jour de deuil aussi intense, dans une tradition fondée sur la joie et la construction ? Ensuite, pourquoi ce jour est-il qualifié de Mo’ed, avec ses accents festifs ? Enfin, pourquoi cette volonté de clore si vite le deuil, alors que la catastrophe, historiquement, atteignait son apogée après le 9 Av ? Ces tensions révèlent la profondeur du 9 Av — et l’enjeu spirituel qu’il représente.
9 Av, date de naissance du Machia’h
Comme mentionné, le 9 Av, malgré la profondeur du deuil, on ne récite pas les Ta’hanounim. L’auteur du Michna Beroura, important ouvrage halakhique de référence, explique ainsi ce paradoxe : ces jours de souffrance seront, à l’avenir, transformés en jours de joie avec la venue du Machia’h et la reconstruction du Temple. Autrement dit, le deuil porte déjà en elle une promesse de consolation. Une idée étonnante, mais enracinée dans un Midrach fascinant, qui illustre ce renversement de manière presque mystique :
- Un homme était en train de labourer son champ lorsqu’un de ses bœufs se mit à beugler.
- Un Arabe passait par là et lui demanda : « Qui es-tu ? »
- Il répondit : « Je suis Juif. »
- L’Arabe lui dit : « Détache ton bœuf, enlève ton soc. »
- L’homme demanda : « Pourquoi ? »
- L’Arabe répondit : « Parce que le Temple des Juifs vient d’être détruit. »
- Stupéfait, le Juif demanda : « Et comment le sais-tu ? »
- Il répondit : « Je l’ai entendu dans le beuglement de ton bœuf. »
- À peine avait-il fini de parler que le bœuf beugla à nouveau.
- L’Arabe lui dit alors : « Attelle ton bœuf, remets ton soc — car le Rédempteur des Juifs vient de naître. »
- Le Juif demanda : « Quel est son nom ? »
- Il répondit : « Il s’appelle Menahem, le Consolateur. »
Cette scène se passe le jour même de la destruction du Temple : un homme continue de labourer, inconscient de l’effondrement en cours. Il faut qu’un non-Juif l’interpelle pour qu’il prenne conscience du drame. Mais aussitôt le choc annoncé, vient déjà la consolation : le Machia’h est né. Au cœur même de la ruine, la rédemption commence.
Ce récit incarne le paradoxe du 9 Av : destruction et consolation coexistent. La fin porte déjà en elle un nouveau départ. D’ailleurs, le Talmud formule la promesse de la reconstruction au présent : « Celui qui s’endeuille sur Jérusalem, la voit dans sa joie. » Le deuil sincère ouvre immédiatement la porte à la rédemption.
Le Rav Eliahou Dessler, dans son ouvrage Mikhtav Mé-Eliyahou, soulève un point essentiel qui éclaire d’un jour nouveau la signification profonde du 9 Av — et, surtout, sa nécessité au sein même de la tradition juive.
Il attire notre attention sur un élément souvent négligé : les Haftaroth, ces passages tirés des Prophètes que nous lisons chaque Chabbath après la lecture de la Torah. Trop souvent survolées ou reléguées au second plan, elles jouent pourtant un rôle central dans le rythme spirituel de l’année juive. Chaque Haftarah est en effet choisie en écho à la Paracha de la semaine ou au moment que traverse le peuple juif : elles traduisent l’âme du calendrier.
Ainsi, les trois semaines qui précèdent le 9 Av, connues sous le nom de Chlocha de-Pour’anoutha — les « trois semaines de calamité » — sont accompagnées de Haftaroth sombres, remplies d’avertissements prophétiques, de visions de destruction, d’exil, de rupture. Le ton est grave, et l’atmosphère de plus en plus pesante, comme une montée vers un sommet de douleur.
Mais c’est précisément ce basculement que Rav Dessler met en lumière : dès le Chabbath qui suit le 9 Av, une transformation radicale se produit. Nous entrons dans une nouvelle période appelée Chiva’ de-Né’hamatha, les « sept semaines de consolation ». Durant ces sept semaines consécutives, les Haftaroth changent de tonalité. Finis les avertissements, place à l’espérance. On parle de rédemption, de reconstruction, de retour vers Dieu. Ces lectures nous préparent à Roch ha-Chana, Kippour, et aboutissent à Soukoth — une véritable montée vers la joie et la proximité divine.
Ce que nous enseigne Rav Dessler est alors d’une puissance redoublée :
- Savoir relier les éléments.
Il nous invite à faire des liens — entre les textes, les périodes, les états d’âme. C’est là un principe fondamental du judaïsme : l’unité. Ce que l’on appelle l’unicité divine (Yi’houd ha-Chem), c’est aussi cette capacité à relier des éléments a priori opposés — la joie et la tristesse, l’espoir et le deuil, la destruction et la reconstruction. Le deuil du 9 Av n’est pas une parenthèse stérile : il s’inscrit dans un continuum, entre les trois semaines de préparation et les sept semaines de consolation. Le 9 Av n’a de sens que parce qu’il est un passage, un pivot. - Savoir s’arrêter pour mieux avancer.
Le second enseignement fondamental, c’est qu’on ne peut pas construire sans pause. Il faut savoir s’arrêter, pleurer, faire le point. Reconnaître que notre vie est imparfaite, que nos âmes sont fracturées. Trop souvent, on cherche à « passer à autre chose » sans affronter nos blessures. On veut l’action, le renouveau, la croissance. Mais sans temps d’arrêt, sans deuil, on est dans le déni, pas dans l’évolution.
Le 9 Av est cette étape de lucidité. C’est la seule journée de l’année où l’on nous ordonne de pleurer — pas pour sombrer, mais pour transformer.
Et cela nous mène directement au 15 Av, Tou be-Av, le jour où, selon la tradition, les couples se forment, les jeunes filles dansent dans les vignes, et la vie reprend avec éclat. Ce n’est pas un hasard : le 15 Av se situe exactement 40 jours avant le 25 Eloul, jour de la création du monde selon la tradition. Or, le Talmud enseigne qu’une voix céleste proclame le destin d’un homme 40 jours avant sa conception : « Untel se mariera avec unetelle. » Le 15 Av est donc le jour où les destinées du monde prennent forme.
Le message est puissant : le monde a un sens, et ce sens commence à s’écrire là, au cœur de l’été, quelques jours à peine après la nuit la plus noire de notre histoire. Le 9 Av nous fait toucher du doigt nos failles ; le 15 Av nous invite à les intégrer pour construire. Ce n’est qu’en prenant pleinement conscience de nos manques que nous pouvons avancer vers une vie pleine de sens, jusqu’à Roch ha-Chana (lorsque les sept semaines de consolation se terminent), Kippour, et enfin, la joie de Soukoth — le rendez-vous ultime avec D.ieu.