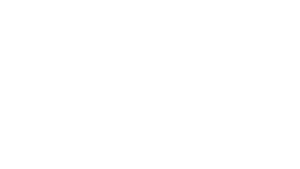En 1946, à l’issue du procès de Nuremberg, onze responsables nazis sont condamnés à mort, dont 10 seront effectivement pendus (Göring s’étant suicidé avant l’exécution, ce qui permettra, Streicher ayant crié « Purim Fest » juste avant son exécution, de faire le rapport avec la pendaison des 10 fils de Haman). Et tous les autres ?
Le procès de Nuremberg s’était voulu symbolique et n’avait visé que les plus hauts responsables sur lesquels on avait pu mettre la main. Il a été suivi d’autres procès dits « secondaires », mais des milliers de nazis, et non des moindres, avaient échappé aux mailles du filet. Tous n’ont pas fui. Certains n’en ont pas eu besoin. En RFA, des milliers de fonctionnaires nazis ont repris leur poste après un stage de silence. Mais c’étaient les plus petits. Quant à, par exemple, Mengele et Alois Brunner, ils sont morts au Brésil et en Syrie, sans jamais avoir été interpellés ni jugés.
Alors que seule une infime minorité de Juifs avaient pu être sauvés pendant la guerre, grâce à des réseaux de résistance et des initiatives courageuses d’individus anonymes ou de diplomates comme Raoul Wallenberg ou Sugihara, les nazis ont bénéficié de la protection organisée d’institutions, d’États et de réseaux religieux, qui les ont accueillis, leur ont fourni de nouvelles identités et les ont parfois réutilisés à leur propre profit.
Les « Ratlines »
Dès 1945 se sont mis en place des réseaux d’exfiltration extrêmement efficaces, surnommés « Ratlines » (les « routes des rats ») par les Alliés, qui ont permis à de nombreux criminels de fuir l’Europe où ils étaient recherchés.
Ces routes partaient souvent d’Allemagne ou d’Autriche vers l’Italie – en particulier Rome ou Gênes – puis vers l’Amérique du Sud, notamment l’Argentine de Juan Perón, mais aussi le Paraguay, la Bolivie ou le Brésil. Une autre direction moins connue conduisait vers le Moyen-Orient. L’Égypte, la Syrie, et d’autres pays arabes ont accueilli d’anciens nazis, parfois pour leurs compétences techniques, parfois pour leur hostilité commune envers Israël ou le communisme.
On les équipe de faux documents, de passeports fournis par la Croix Rouge, de visas en bonne et due forme, le tout dans l’indifférence, si ce n’est la complicité, des autorités locales. Et alors que la France avait été il y avait si peu de temps encore une terre de résistance, certaines régions françaises – notamment dans le Sud – deviennent des zones de transit privilégiées pour les fugitifs nazis en tant que refuge temporaire vers les terres accueillantes de l’Amérique latine. Ainsi Klaus Barbie fuit en Bolivie, d’où il ne sera extradé et jugé qu’en 1987. Quant à Touvier, il vit caché en France pendant des décennies, abrité par des milieux catholiques intégristes. Gracié par Pompidou, il sera néanmoins arrêté en 1989 (grâce à l’initiative des Klarsfeld) et condamné à la réclusion à perpétuité. Il mourra en prison à l’âge de 81 ans. Il est d’ailleurs remarquable qu’à l’exception notoire d’Eichmann, la plupart des nazis qui ont fini par être retrouvés et jugés sont morts tranquillement en prison, logés et nourris aux frais de l’État, et à un âge souvent très avancé. Pauvres nazis.
Les pays d’accueil
Il est peu probable qu’un criminel de guerre recherché ait pu trouver asile incognito dans un pays totalement innocent. Il fallait donc trouver des pays d’accueil soit favorables à leur idéologie, soit tout au moins indifférents, soit intéressés par les talents des réfugiés en question. L’Argentine est sans doute celui qui a joué le plus grand rôle. Juan Perón, sensible à l’idéologie fasciste, a accueilli de nombreux anciens nazis, parfois avec l’aide directe de l’Église ou des ambassades. Ainsi n’a-t-il pas hésité à donner abri à Eichmann, Mengele et Franz Stangl, entre beaucoup d’autres. D’autres pays d’Amérique du sud, comme le Brésil, la Bolivie ou le Paraguay, ont également contribué à cette œuvre charitable.
Mais il y avait aussi ailleurs d’autres pays, qui sans nécessairement partager tous les aspects de l’idéologie nazie, ne voyaient pas d’un mauvais œil les héros de l’extermination du Juif. De plus, ces derniers pouvaient leur être utiles. Dans l’Égypte de Nasser, des anciens officiers SS, des ingénieurs de l’aéronautique ou des spécialistes de l’interrogatoire ont été recrutés pour former les services secrets égyptiens, travailler sur les programmes d’armement ou aider à lutter contre Israël. La Syrie a de son côté abrité Alois Brunner (le bras droit d’Eichmann) pendant des décennies, et on a tout lieu de penser qu’il a formé des officiers syriens aux techniques de renseignement. L’Irak, et peut-être même l’Algérie d’après certains documents, ont également été mentionnés dans des archives déclassifiées comme ayant accueilli d’anciens nazis dans une perspective de lutte antisioniste.
De leur côté, les Américains, à qui l’ont devait pourtant la fin de la guerre, n’ont pas dédaigné, après avoir donné asile à Einstein, de recevoir également des centaines de scientifiques allemands qui n’avaient pas tous les mains propres. D’autres ont également été « recyclés » par les Soviétiques. N’y a-t-il pas un proverbe africain qui dit « Les morts sont morts, les vivants vont au marché » ? D’ailleurs la morale, c’est le problème des Juifs, non ?
Le rôle de l’Église
On aurait pu espérer que ce soit aussi le problème de l’Église, après tout. Et gardons-nous bien d’oublier tous ces chrétiens, parmi lesquels de nombreux prêtres et religieux, qui ont sauvé des milliers de Juifs au péril et parfois au don de leur propre vie. Ce sont des paroisses entières, des couvents, des communautés protestantes (notamment en France, en Suisse et aux Pays-Bas) qui ont organisé des filières clandestines à leur bénéfice.
Mais ils n’ont pas été les seuls à organiser. Il est question ici de ceux qui, représentant l’Église officiellement, ont manifesté soit un soutien efficaces aux nazis en fuite, soit tout au moins un silence discret à leur égard. Pour une partie du clergé, mieux valait un antisémitisme chrétien qu’un marxisme athée.
Le plus connu d’entre eux est sans conteste Alois Hudal, évêque autrichien basé à Rome et de tous temps très ouvertement favorable au nazisme. Ainsi, dès 1937, il offre à Hitler un exemplaire de son livre « Les Fondements du National-socialisme », en le dédicaçant au « Nouveau Siegfried de la grandeur de l’Allemagne », pas moins. Son engagement politique était dû surtout au fait que le nazisme s’opposait au communisme, qui était la bête noire de l’Église, mais il était par ailleurs sans surprise ouvertement antisémite. Dans ses ouvrages, il explique : « J’ai remercié Dieu de m’avoir permis de visiter et de consoler nombre de ces soldats perdus [il s’agit des nazis], que la haine des vainqueurs considérait comme des criminels. Ce que j’ai fait pour eux, je le considère comme un devoir chrétien de charité envers ceux que la guerre avait brisés [tels Eichmann, Mengele, Stangl…]. » Il a toujours refusé de reconnaître la gravité spécifique des crimes nazis envers les Juifs, les réduisant à des actes de guerre ou de défense contre le bolchevisme.
Un autre réseau actif était dirigé par Krunoslav Draganović, prêtre catholique oustachi, qui disposait de complicités diplomatiques (notamment avec l’ambassade d’Argentine) et d’un soutien logistique local.
Et le Vatican ? Sans qu’on puisse l’accuser d’avoir participé directement à ces opérations, le cœur des Ratlines passait toutefois par Rome, parfois à quelques centaines de mètres du Vatican (les criminels de guerre logeaient souvent dans des bâtiments ecclésiastiques), lequel ne pouvait pas en ignorer l’existence, et n’a rien fait de public ni d’efficace pour y mettre fin. Alerté par des diplomates étrangers, il répondait soit par le silence, soit par des protestations formelles de neutralité religieuse.
Le procès de Nuremberg avait-il rassuré les consciences ? Pouvait-on désormais passer à l’ordre du jour ? L’ouverture d’archives (du Vatican, des Nations Unies, d’institutions mémorielles comme Yad Vashem) qui continuent à être étudiées nous invite à une réflexion sur la mémoire, la responsabilité et les limites de la réconciliation après un conflit majeur. Et aujourd’hui, de tristes souvenirs remontent à la mémoire collective du monde entier, pour nous rappeler que rien n’a été ni appris ni oublié.