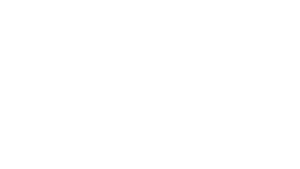D’une voix blanche mais ferme, elle commence son impressionnant récit, celui du combat héroïque de Juifs prêts à mourir, mais les armes à la main. Elle raconte entre autres choses cette rencontre chargée d’émotion, le deuxième soir de la révolte (19 avril 1943) : elle vient d’entrer dans un bunker où se déroule le dernier Séder de Pessa’h tenu dans le ghetto. Plusieurs des figures rabbiniques les plus respectées du ghetto y participent, qui ne voyaient généralement pas d’un bon œil les activités des mouvements clandestins, par crainte des terribles représailles des Allemands. L’un d’eux, Rabbi Elièzer Yits’hak Meisel, se dresse pourtant et interrompt le Séder, il élève ses mains au-dessus de la tête de la jeune femme pour la bénir, et fait cette déclaration étonnante : » Bénis soyez-vous ! il m’est plus facile de mourir maintenant, dommage que nous n’ayons pas commencé plus tôt ! «
Cette déclaration, pour émouvante qu’elle soit, est étonnante, car les avis divergent jusqu’à ce jour quant au bien-fondé et à la légitimité d’une révolte armée dans les conditions données : face aux Allemands au faîte de leur domination en Europe, quel espoir pour les Juifs dans un combat désespéré et voué à l’échec ? La Loi juive autorise-t-elle de sacrifier sa vie en toute circonstance ?
Varsovie, nouveau Massada ?
Beaucoup, en Israël ou ailleurs, ont voulu voir dans la révolte du ghetto de Varsovie (on sait que, dans d’autres ghettos et dans certains camps, des Juifs ont eux aussi pris le risque d’affronter physiquement les Allemands) une sorte de version moderne du sacrifice héroïque des défenseurs de Massada, trois ans après la prise de Jérusalem et la destruction du Second Temple : selon un narratif qui a connu jusqu’à ce jour un grand succès en Israël (surtout en rapport avec la décision d’établir le Yom ha-Choa ve-ha-Guevoura, la journée de la Shoah et de la vaillance) on aurait là, au-delà des siècles, l’exemple de Juifs décidés à lutter jusqu’au sacrifice ultime afin de ne pas tomber aux mains ou sous les coups de l’ennemi.
Une différence fondamentale apparaît pourtant à l’évidence, qui devrait empêcher toute comparaison entre ces deux événements historiques. En effet, les Juifs réfugiés dans la forteresse impressionnante de Massada, sur les bords de la Mer Morte, appartenaient à une mouvance qui avait fait, en conscience, un choix redoutable : combattre jusqu’au bout les forces romaines, rejeter toute reddition, refuser toute soumission à un esclavage cruel ; rejeter également le message du grand maître de l’époque, Rabbi Yo’hanan ben Zakkaï, qui s’était enfui de Jérusalem pour se soumettre aux Romains et se réfugier avec le Sanhédrin dans la petite ville de Yavné. Et ainsi assurer l’avenir du peuple juif.
Comment alors comparer ce combat, certes héroïque et émouvant, mais délibérément suicidaire, avec celui des jeunes du ghetto ? Les Juifs de Varsovie n’auront en effet pris les armes qu’après avoir compris qu’ils n’avaient plus d’autre choix, les Allemands ne leur promettant que la mort. Alors que les Allemands et leurs auxiliaires, lourdement armés, entraient dans le ghetto pour en « liquider » les derniers survivants, ils seront quelques centaines de jeunes gens et jeunes filles, armés de pistolets, grenades et cocktails Molotov, à leur livrer un dernier combat « pour l’honneur ». Ils répondent à l’appel de Mordekhaï Anilewicz : » Nous nous battons, non pour la vie, mais pour le prix de la vie ; non pour éviter la mort ; mais pour la manière de mourir. »
Le pour…
Les compagnons d’Anilewicz ou ceux de Pavel Frankel, à l’autre extrémité de l’éventail des partis politiques œuvrant dans le ghetto, n’ont certes pas fondé leur action sur des critères tirés de la Halakha, la législation juive. Mais l’opinion des autorités rabbiniques encore présentes dans le ghetto leur était connue et ils se devaient d’en tenir compte pour s’adresser à la population. Or que disaient-ils ?
Certains d’entre eux partageaient l’opinion du Rav Yechaya Shapira, dirigeant ‘hassidique surnommé le Admor hé-‘halouts (le pionnier) qui se trouvait déjà en Erets Israël mais dont le frère aîné, le charismatique Rabbi de Piaseczne, était l’une des principales figures ‘hassidiques à Varsovie : Rabbi Yechaya voyait dans la lutte armée une forme de Kiddouch ha-Chem (sanctification du Nom), car les Nazis voulaient l’anéantissement complet du peuple juif et, à travers lui, de la « conscience juive ». Il n’y avait donc aucun sens à respecter leurs ordres et injonctions ; il fallait au contraire, là et quand on le pouvait, lutter contre eux les armes à la main même si une mort certaine en découlait, afin de montrer que le sang du peuple d’Israël, peuple de la Tora et de la Loi morale, ne pouvait être versé impunément.
Les partisans de cette vision des choses y voyaient aussi une manière de défendre l’honneur du peuple juif et de remonter le moral de la population dans cette période tourmentée : mieux valait mourir les armes à la main que conduits comme des moutons à l’abattoir, et mieux valait venger, autant que possible pour des mains humaines, le sang juif répandu.
Certains ajoutaient encore : une révolte armée n’a certes aucune chance de réussir à sauver tous les Juifs, mais au moins pourrait-t-elle freiner ou même interrompre le processus de l’extermination ; une partie de la population du ghetto pourrait en profiter pour parvenir à s’enfuir ; certains pourraient finir par échapper aux rafles et aux déportations et, qui sait, un revers de leur situation militaire sur le front russe pourrait entre temps conduire les Allemands à cesser massacres et déportations…Sans compter les bombardements massifs effectués depuis cette année-là par les Anglo-Américains sur toute l’Europe (sauf, mais c’est un autre et douloureux sujet, sur les ponts, routes et voies ferrées conduisant à Auschwitz…) : la dynamique de la guerre était certainement en train de basculer en faveur des Alliés, offrant aux Juifs, pensaient-ils, de meilleures chances d’obtenir des succès même minimes face aux Nazis.
Certains, enfin, espéraient un geste de solidarité de la part des Polonais, eux-mêmes durement éprouvés, pour soutenir la révolte juive. Il ne vint pas. Seuls quelques uns d’entre eux, remarquables dans leur courage et leur compassion, répondirent à l’appel de la conscience humaine.
Et le contre…
D’autres opinions se faisaient pourtant entendre entre les murs du ghetto, et même au-delà. L’opposition la plus ferme aux activités clandestines des mouvements de jeunesse appelant à la révolte, provenait essentiellement des milieux ‘hassidiques tels que ceux de Satmar et de Belz. Plusieurs niveaux d’argumentation étaient mis en avant :
- Le peuple juif est confronté à une épreuve d’extermination sans précédent. Il convient d’accepter les décrets de la Providence divine et, comme à Pourim face à Haman l’amalécite, de prier et de multiplier les actions positives qui, seules, nous feront mériter la délivrance des mains cruelles qui nous assaillent.
- Toute révolte armée est vouée à l’échec et représente donc un acte suicidaire prohibé par la Halakha. Un tel échec pourrait alors avoir l’effet inverse du Kiddouch ha-Chem.
- Dans ce combat inégal qui nous est imposé, l’urgence est au Kiddouch ha-‘Hayim, la sanctification de la vie, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour garder en vie le plus grand nombre de Juifs. Car chaque minute de vie dans ce monde possède une valeur inestimable.
- Une telle révolte exposerait la population du ghetto à de terribles représailles de la part des Nazis. D’autres moyens s’offrent encore à nous pour sauver des vies : par exemple, par certaines brèches dans la muraille ou par les égouts, faire passer du côté « aryen » le plus possible d’enfants, de femmes et de vieillards, de toute façon inaptes au combat.
- La législation juive ne nous enseigne-t-elle pas, dans une situation de doute, qu’il convient d’appliquer le principe de : « Chev ve-al-ta’assé » (Reste assis et ne fais rien) ?
Telle était la position, notamment, du grand-rabbin de Varsovie, le Rav Mena’hem Zemba. Cette remarquable et très respectée personnalité considérait qu’il fallait privilégier toute forme de « résistance passive », permettant de gagner du temps : les chefs nazis étaient, à Varsovie comme dans l’entourage même du Führer, très sensibles à l’attrait des pots-de-vin, ce qui pouvait permettre d’envisager un moratoire ou un allègement des mesures prises à l’encontre des Juifs ; des opportunités inespérées de trouver de nouvelles cachettes, et de nouvelles voies de prendre la fuite pouvaient toujours se présenter…
Le Rav Mena’hem Zemba allait, en même temps que sa fille, trouver la mort sous les balles allemandes durant les combats menés par la résistance juive. Il semble bien qu’à l’instar du Rav Meisel évoqué en début d’article, il ait fini par donner sa bénédiction à la révolte des jeunes du ghetto : face à l’implacable vibration meurtrière qui animait les Allemands, et toutes les voies de salut s’étant hélas fermées, il s’imposait maintenant de donner la priorité à la vibration éternelle de l’âme juive, animant le dernier combat de ces Juifs « pour le prix de la vie ».