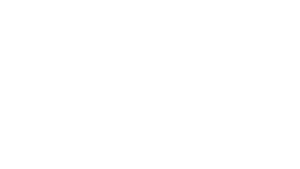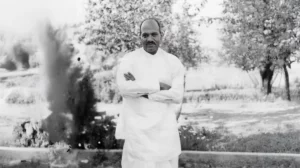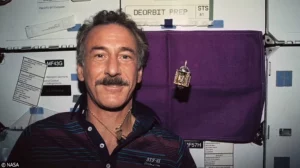À la différence d’autres pays arabes, le Maroc n’a jamais organisé de véritable expulsion des Juifs. Pourtant, entre 1948 et les années 1970, la quasi-totalité des 250 000 Juifs marocains a quitté le pays, principalement vers Israël, la France et le Canada. Contrairement aux grands récits épiques associés aux migrations des Juifs d’Irak, du Yémen ou d’Éthiopie (comme les opérations « Tapis magique » ou « Moshé »), l’exode des Juifs marocains ne se raconte pas comme une glorieuse épopée et suscite chez beaucoup un certain malaise quant à son déroulement.
Une nostalgie persistante
L’émigration des Juifs marocains n’a jamais été totalement digérée ni par ceux qui sont partis ni par ceux qui sont restés. Les émigrés, où qu’ils se trouvent de nos jours, ressentent une forte nostalgie pour le Maroc, tandis que de nombreux musulmans marocains gardent la blessure silencieuse du départ de leurs anciens voisins. Ce double traumatisme n’a que rarement été ouvertement exprimé, même si des oeuvres récentes comme Adieu mères ou Où vas-tu Moshe ? commencent à explorer ce refoulé.
Les raisons du départ
Plusieurs vagues migratoires se succèdent :
- 1948-1956 : Motivés surtout par la ferveur sioniste (soigneusement surveillée par les autorités françaises) et l’espoir d’une vie meilleure, 90 000 Juifs quittent le Maroc. Parmi eux, de nombreux enfants et adolescents naïvement confiés aux représentants de la Aliya par leurs parents, mais envoyés en Israël dans des kibboutsim non religieux.
- 1956-1964 : Après l’indépendance et l’adhésion du Maroc à la Ligue arabe, l’émigration clandestine s’intensifie, facilitée par les réseaux du Mossad.
- Après 1964 : La situation économique, la montée du nationalisme arabe et l’islamisation de la société poussent à de nouveaux départs. La guerre des Six Jours en 1967 aggrave encore le climat, avec des actes antisémites sporadiques, comme l’assassinat de deux jeunes Juifs à Meknès.
Entre refoulement et culpabilité
Chez beaucoup de musulmans que l’ont peut interroger, le départ des Juifs est souvent minimisé ou attribué à la volonté des Juifs eux-mêmes, influencés par le sionisme ou des promesses d’une vie meilleure sous d’autres cieux. Rarement, le climat d’insécurité ou les violences subies sont reconnus. À Meknès, par exemple, l’assassinat de deux jeunes Juifs en 1967 est largement oublié du côté musulman, alors qu’il reste un traumatisme fort chez les Juifs originaires de cette ville.
Le poids de la mémoire
La mémoire collective juive, nourrie par les visites aux anciens mellahs et les pèlerinages, continue d’entretenir le souvenir d’un Maroc aimé mais perdu. À l’inverse, la mémoire
musulmane, soucieuse de préserver l’image d’un Maroc tolérant, tend à occulter les tensions de l’époque.
Une histoire d’individus avant tout Au-delà des grandes causes politiques et idéologiques, les témoignages montrent des histoires très humaines : la peur pour l’avenir des enfants, la crainte des mariages mixtes, l’angoisse d’un avenir incertain. Dans bien des cas, ce sont les jeunes qui ont poussé leurs familles à partir, souvent contre la volonté initiale des parents.
Une blessure partagée Le départ des Juifs marocains a laissé un vide. Les musulmans du souk de Meknès, encore aujourd’hui, parlent avec émotion de leurs anciens voisins. Mais derrière la nostalgie se cache aussi un malaise : celui d’une brève coexistence à l’époque française, brisée dans le cours des événements du XXe siècle, et d’une histoire commune trop souvent méconnue.
Documenté en partie sur la base de : https://books.openedition.org/cjb/174?lang=fr
Ci-dessous, ce documentaire sur la vie des Juifs au Maroc, avant leur exode dans le cadre de l’opération Yakhin, ne doit pas tromper : on y voit certes des scènes authentiques de la vie de ces Juifs ; mais il ne s’agit-là que de scènes choisies pour leur côté pittoresque et exotique ; et dans une partie seulement de la société juive marocaine. Le but du documentaire est alors clair : montrer le mode de vie assez misérable de ces Juifs, vivant « comme aux temps bibliques » ainsi qu’on nous le fait entendre ; et, en contrepoint, valoriser l’action des jeunes et dynamiques émissaires de l’Agence Juive,les persuadant de les suivre pour rejoindre le jeune État d’Israël.