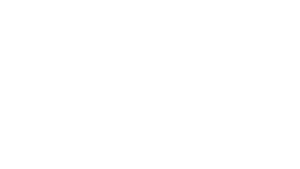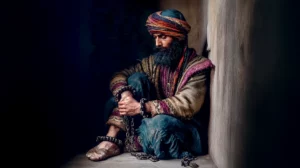Une étoile filante a traversé le ciel de Paris, ce Paris de l’après-guerre où ce qui restait des Juifs, français de naissance ou très souvent d’adoption, tentait de retrouver un sens, dans une ébullition intellectuelle sous arrière-fond de traumatisme profond, à la redécouverte des textes et au dialogue avec la philosophie moderne ; par-dessus tout, on y brûlait d’un besoin de répondre à la Shoah par la pensée, l’étude, l’engagement spirituel.
C’est dans ce terrain fertile qu’est apparu, venant de nulle part et n’allant nulle part, une espèce de phénomène de l’esprit qui a laissé des traces indélébiles dans la mémoire de tous ceux qui l’ont fréquenté, pour le meilleur et pour le pire. On l’appelait Monsieur Chouchani. Était-ce son vrai nom ? Certainement pas. Comment s’appelait-il alors ? Personne ne l’a jamais su avec certitude, car il a soigneusement veillé à ce qu’il soit impossible de retrouver ses traces. Il s’est fait appeler au gré du vent Chouchani, Chouchana, Mordekhaï Soussan, Rosenblum, Ben-Shoushan, Rosen, Mardochée Bensoussan. Sa pierre tombale porte quatre identités différentes : Mardoqueo Bensoussan, Chouchani, Ohona et Mordechaï Ben Sasson. Il est vrai que récemment, de nombreux éléments tendent à indiquer avec une grande probabilité qu’il s’agissait sans doute d’un certain Hillel Perelman, né à Brisk en 1895. Mais sait-on jamais ? Peut-être les documents en question sont-ils une ultime fausse piste, un piège qu’il nous a tendu d’outre-tombe…
Il avait la passion de l’enseignement, et dans tous les pays où il a laissé des traces, sous un nom ou sous un autre, c’est à cela qu’il s’adonnait, partout, parlant à des intellectuels comme à des jeunes curieux, mais aussi parfois dans des écoles juives plus traditionnelles. Il avait une manière de s’adresser à tous les niveaux, selon les personnes présentes. C’est la chose la plus certaine que l’on connaisse de lui.
Mais pourquoi l’écoutait-on, et pourquoi fascinait-il au point d’être resté dans les mémoires comme un être un peu mythique ?
Une maîtrise des textes prodigieuse
Tous les témoignages concordent : il était doué d’une mémoire, d’une connaissance des textes et d’une intelligence tout à fait exceptionnelles. Dans le livre qu’il lui a consacré, Salomon Malka rapporte que dans sa petite enfance, son père l’aurait exhibé dans les foires comme enfant prodige doué d’une mémoire phénoménale. Cette anecdote n’a toutefois été confirmée par aucun autre chercheur. Quoi qu’il en soit, il connaissait par cœur le Talmud dans son intégralité, commentateurs inclus. Il aimait à pratiquer son « tour », qui consistait à piquer une épingle dans 5 ou 6 pages d’un volume du Talmud, et à donner, les yeux fermés et sans la moindre hésitation, tous les mots que l’épingle avait traversés. Il pouvait également citer des pages entières de mémoire à partir d’une expression qui lui était donnée au hasard, et s’empressait de corriger une citation mal faite, même lorsqu’elle provenait d’un grand érudit. Elie Wiesel rapporte que lorsqu’un élève demandait à Chouchani : « Où cela est-il écrit ? », il répondait : « C’est la page 67b du traité Pessa’him, troisième ligne en bas, après les mots ‘amar Abayé’ – et il avait raison. André Neher et Emmanuel Levinas racontent qu’il pouvait « reconstruire » un livre qu’il avait lu une seule fois, y compris sa structure logique et argumentative.
Il parlait un grand nombre de langues (français, allemand, hébreu, divers yiddishs, arabe, anglais, espagnol) et comprenait le ladino, le russe, le hongrois, etc. Il les apprenait rapidement dans des dictionnaires, y compris les langues anciennes, et probablement le sanskrit.
De plus, il s’intéressait à toutes les sciences modernes, mathématiques, physique théorique (il pouvait discuter des équations d’Einstein), logique, philosophie grecque et allemande, et citait avec une grande aisance Spinoza, Kant, Hegel, mais aussi Einstein ou Newton, l’histoire des sciences, la grammaire comparée, sans parler de la littérature de plusieurs pays, qu’il possédait parfaitement.
Le seul hic, c’est qu’il aimait à faire étalage de ses dons et prenait fort mal la moindre contradiction. Personne n’est parfait.
Mais ce n’était pas simplement de la mémoire. Il était doué d’une intelligence intuitive et fulgurante. Il était capable, en entendant quelques mots, de remonter à la source d’un texte, d’en expliciter les implications cachées. Il avait une intelligence de synthèse qui unissait des savoirs en apparence hétérogènes. Et il savait déceler instantanément les failles dans un raisonnement ou les incohérences d’une position, que ce soit dans la lecture du Talmud ou dans une théorie scientifique. Ce n’est pas seulement qu’il savait tout, il pensait autrement. Il pensait la Torah avec la rigueur des mathématiques, et abordait la physique quantique comme un midrash. Cette forme d’intelligence intégrative et interdisciplinaire étonnait tous ses interlocuteurs.
Sa méthode pédagogique
Il aimait enseigner, mais il n’était pas un maître au sens classique. Il n’avait aucune pédagogie. Pour ceux qui ne savaient pas grand-chose ou qu’il trouvait tout simplement médiocres, son discours était si rapide et si compliqué qu’ils n’y comprenaient rien, il n’avait aucune patience avec eux et pouvait même se montrer extrêmement blessant.
Quant à ceux chez qui il décelait un grand potentiel, il était avec eux encore plus intransigeant. Il ne cherchait pas à transmettre un savoir, mais plutôt à créer un éveil de la pensée. Les témoignages sont nombreux à ce sujet : il posait des questions déroutantes, déstabilisantes, souvent provocantes, destinées à briser les croyances et les certitudes. Il démolissait le monde intérieur de l’élève, dans le but que ce dernier en reconstruise un autre plus exigeant, plus proche d’une vérité d’ailleurs élusive. Mais il ne l’aidait pas à se reconstruire, et certains en sont sortis brisés.
Lorsqu’il donnait des cours devant un public plus large (il parlait n’importe où, dans les cafés, dans le métro, dans les synagogues, dans les cuisines), il avait un charisme certain, et les auditeurs en sortaient médusés, fascinés, à la fois par son érudition prodigieuse, son intelligence qui donnait un sentiment de vertige intellectuel, et certainement une très grande présence. Et pourtant, une fois le météore disparu, personne n’était plus capable de répéter ses enseignements ni même de savoir ce qu’il avait dit au juste.
Le côté sombre
On a du mal à évoquer un aspect pourtant bien connu de sa personnalité, mais qui dérange si terriblement chez un personnage que l’on rêve d’admirer. C’est « Manitou »(Léon Ashkenazi) qui l’a dit de la façon la plus claire : « Il y avait des gens qui disaient : il est 50% fou et 50% génie – mais c’est faux. Il était 100 % génie et 100% fou ! » Fou, et d’une folie bien désagréable. Les témoignages à ce propos sont innombrables, et le dépeignent comme un clochard, frustre, menteur, voleur, malpropre, un vagabond qui ne « sentait pas la rose », un peu fétichiste, aux très mauvaises manières et à la morale douteuse. Il prenait également en public des libertés avec la halakha. Inutile de s’attarder. On peut se demander si cette attitude anti-sociale par excellence provenait de son désir de dissimuler sa véritable personnalité, de bousculer toute façon classique de réfléchir et de réagir, ou d’un profond désordre psychologique, qui n’est d’ailleurs pas rare chez les génies Il y avait probablement un peu de tous ces éléments dans la folie de Chouchani.
Son influence
Chouchani n’a laissé aucun écrit, officiellement du moins. Il est vrai qu’on a retrouvé après sa mort des quantités de cahiers dans lesquels il semble qu’il prenait des notes, mais que jusqu’à présent personne n’a encore réussi à déchiffrer, tant il écrivait dans une graphie énigmatique, mêlant des symboles, des abréviations, plusieurs alphabets, des notations personnelles et des jeux de mots hermétiques. Personne n’a non plus réussi à transmettre par écrit des enseignements cohérents entendus de lui. Et pourtant, il a eu un impact profond sur le réveil de la pensée juive après la Shoah, par l’intermédiaire de figures majeures de cette renaissance. Il y en a eu d’autres, mais citons essentiellement Léon Ashkénazi (Manitou), Elie Wiesel et Emmanuel Levinas.
– « Manitou » le rencontre au début des années 50, et il est impressionné par son érudition et son intelligence hors normes, mais aussi par sa lecture profonde, rigoureuse, et structurée des textes juifs et son exigence intellectuelle absolue. C’est sous son influence qu’il a plus tard développé une pensée centrée sur la mission d’Israël. Il l’a invité à donner des cours à l’école d’Orsay, mais cette collaboration n’a pas duré très longtemps, Manitou se montrant réticent à la fois envers sa méthode pédagogique (il détruisait mais sans jamais reconstruire) et sur la mauvaise influence que ses « bizarreries » auraient pu avoir sur les élèves. Il n’en demeure pas moins qu’il a prolongé la pensée de Chouchani, dont il est peut-être l’un des seuls à avoir tiré de son enseignement une pensée systématique.
– Elie Wiesel, encore adolescent, rencontre Chouchani à Paris juste après la guerre. Il a été marqué par lui si profondément qu’il lui restera attaché toute sa vie, dans une relation mêlée d’admiration et de crainte, au point de rédiger ainsi sa pierre tombale : « Ici repose l’homme caché, le vénérable et le génie, M. Chouchani, de mémoire bénie, décédé le 26 Tévet 5717 (27 janvier 1957). Que son âme soit liée au faisceau de la vie. » Il a probablement été pour lui une figure paternelle, et on le retrouve, explicitement ou non, dans plusieurs de ses ouvrages. Il en parle ainsi à Salomon Malka : « C’est un homme unique. Unique, parce qu’il connaissait tout, parce qu’il en savait trop, mais toujours avec quelque chose de plus, quelque chose d’autre. C’était l’étranger, c’était la menace, c’était la promesse[1]. »
– Emmanuel Levinas rencontre Chouchani au début des années 50. Directeur de l’ENIO (École Normale Israélite Orientale), qui forme des enseignants juifs, il fait appel à lui pour enseigner le Talmud à ses élèves. Sans tenir aucun compte de l’aspect vagabond déguenillé du personnage, il se laisse interpeller par la façon dont Chouchani aborde les textes classiques. Il dira de lui : « C’était un dialecticien effrayant. Il pouvait, quand il voulait s’y donner, défendre le lendemain devant les mêmes élèves, presque le contraire de ce qu’il avait enseigné la veille. Avec une virtuosité extraordinaire, mais aussi, chaque fois, avec de nouvelles dimensions de sens ! J’ai conservé un souvenir inoubliable et incommunicable de la vie de l’esprit[2]. » Pendant cette période, il étudie avec Levinas deux fois par semaine, de neuf heures du soir jusqu’à tard dans la nuit. Levinas a toujours affirmé lui devoir beaucoup, à la fois en lui rendant confiance dans un approche résolument juive de la philosophie, et en lui enseignant une méthode rigoureuse d’aborder les textes sacrés.
Ces trois « disciples » de Chouchani ont à leur tour enseigné, chacun à sa manière, qu’on pouvait survivre à la Shoah, parler à l’homme moderne avec ses doutes, ses révoltes et ses exigences, et être à la fois fidèle à la tradition et engagé dans le monde. Ils ont été les piliers de la renaissance intellectuelle du judaïsme francophone.
Chouchani restera à jamais un personnage aussi inoubliable qu’insaisissable, attirant les hommes par son intellect quasiment surhumain, repoussant les femmes par sa sordidité et ses comportements hors normes, dont on peut parler ad infinitum sans toucher quelque chose de concret. En conclusion, retenons pourtant de lui l’un des rares enseignements dont il est resté une trace. Voici un extrait d’une parabole rapportée par « Manitou » au nom de Chouchani : « « Qu’est-ce que la Création ? C’est comme une mère qui prend son enfant et le place loin d’elle pour qu’il apprenne à marcher. Alors le souhait de la mère est double : d’abord que son bébé apprenne à marcher… Mais en même temps… elle souhaite qu’il revienne vers elle. Alors, si cet enfant était capable d’argumenter, il dirait : « Mais Maman, je vais tomber ! » Je vais tomber implique : je vais faire… Mais c’est cela l’apprentissage. Et c’est une dure loi… Il y a le risque de la faute, c’est-à-dire du trébuchement. Et cette crainte de la mère qu’il tombe. Alors doit-elle le prendre dans les bras ? Bien sûr que non, puisqu’il faut qu’il apprenne à marcher.[3] »
[1] Salomon Malka, Monsieur Chouchani, p.46
[2] .Emmanuel Levinas, Transcendence et intelligibilité, p. 67-68.
[3] Cité dans l’ouvrage de Sandrine Szwarc Fascinant Chouchani, qui est la source essentielle de cet article. Ce livre est une véritable « Encyclopédie Chouchani » en 450 pages et contient à peu près tout ce qu’il est possible de connaître de Chouchani à l’époque actuelle.