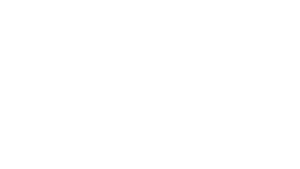Et parce que leur sort nous hante, chaque écho de l’histoire juive qui rappelle une captivité revient avec force. Comme par exemple celle du 26 septembre. Ce jour marquera les 55 ans de la libération d’un des plus grands maîtres de Torah américains, l’auteur de la monumentale série Pa’had Yits’hak et fondateur à Jérusalem de la Yechiva du même nom, Roch Yechiva de la prestigieuse institution new-yorkaise Rabbénou ‘Haïm Berlin. Après trois semaines de captivité aux mains du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), suite au détournement vers la Jordanie du vol TWA 741 le 6 septembre 1970, il fut enfin libéré, aux côtés de sa famille et de plusieurs dizaines de Juifs pris en otages avec lui, peu avant Roch ha-Chana.
Un maître de Torah humilié dans sa chair
Cette date, que beaucoup ont oubliée, resta pour le Rav Yits’hak Hutner une blessure jamais refermée. Les passagers non juifs de l’avion furent rapidement libérés, mais les Juifs restèrent eux prisonniers, dont le Rav Hutner, son épouse, sa fille la Rebbetzin Bruria David et son gendre Rav Yonathan David. Séparé des siens, il est isolé, livré à l’angoisse et à l’humiliation.
Pendant trois semaines, le monde juif retient son souffle. Quand il est enfin libéré, transféré à Chypre puis rapatrié aux États-Unis, c’est un homme méconnaissable : il a perdu de nombreux kilos, marqué jusque dans son âme. Il racontera plus tard que les terroristes ne visaient pas seulement son corps, mais ce qu’il représentait : la dignité d’un maître de Torah. Après des années de travail acharné sur un commentaire du Michné Torah de Maïmonide, ses manuscrits lui furent confisqués. Il racontait aussi cette scène glaçante où l’un des terroristes tenta de lui couper la barbe – dans un geste symbolique d’humiliation. Il fut certes interrompu in extremis par l’un de ses supérieurs, mais l’atteinte morale, elle, était déjà faite.
Ces humiliations, les précieux manuscrits dérobés, cette détention éprouvante en plein désert, marquée par l’angoisse et la solitude, vont accompagner le Rav Hutner tout au long de sa vie, laissant planer comme une ombre tenace sur sa mémoire et sur son enseignement.
Faut-il tout donner pour sauver une vie ?
Or, chaque fois que le peuple juif a été confronté à une prise d’otages, la même question s’est imposée : jusqu’où peut-on aller pour sauver des vies ? Y a-t-il des limites à la Mitsva du rachat des prisonniers – Pidyon Chevouyim ? Du Talmud au Maharam de Rottenbourg, d’Entebbe à Guilad Shalit, et jusqu’à aujourd’hui, la tradition halakhique juive n’a cessé, hélas, de débattre de la légitimité d’un échange pour libérer des captifs.
Car dans toutes les situations où il faut trancher dans des questions de vie ou de mort, la Torah ne permet pas de réponses simplistes. Elle nous impose d’entrer dans la complexité, de confronter les arguments, de sonder les priorités. Adopter une position figée, définitive, ce serait trahir son esprit. Le Talmud en donne une image saisissante : lorsqu’un tribunal jugeait un accusé passible de la peine capitale – ce qu’on appelle dinei nefachot – si tous les juges votaient d’une seule voix pour le condamner, le verdict était automatiquement renversé. L’accusé repartait libre. Comme pour rappeler qu’en matière de vie et de mort, l’unanimité est suspecte, et que la vérité naît toujours de la nuance.
Face à la question des otages, deux sensibilités se font entendre. La première est un élan vital : « On fait tout, absolument tout, pour sauver des captifs. » Rien n’est plus humain, rien n’est plus juif. Les familles implorent, les communautés s’unissent, et le cœur réclame d’abréger l’épreuve, quel qu’en soit le prix.
La seconde relève d’une prudence de responsabilité : « Si nous cédons trop aujourd’hui, que semons-nous pour demain ? » L’expérience l’a en effet bien montré : chaque concession peut encourager un mode opératoire que l’ennemi ne cessera de reproduire. Libérer des terroristes n’est pas un geste isolé, ponctuel : c’est souvent ouvrir une brèche d’où surgiront de nouvelles menaces. Le cas de Yehia Sinwar, libéré lors de l’échange pour la libération de Guilad Shalit et devenu l’architecte du 7 octobre, reste à cet égard exemplaire.
Ce qui interroge le plus, toutefois, ce n’est pas seulement la difficulté du dilemme, mais surtout la façon dont il est souvent abordé : deux positions fermées, deux certitudes qui s’affrontent, plus proches de logiques partisanes que de la recherche sincère de la valeur suprême à placer au-dessus de tout.
Quand sauver une vie peut en mettre mille en danger
Pour revenir au dilemme de la libération du Rav Yits’hak Hutner, les débats de l’époque montrent bien la complexité des priorités en jeu. Le Rav Ya’akov Kaminetski, qui comptait parmi les grands maîtres de Torah aux États-Unis et proche ami du Rav Hutner, s’opposa fermement à toute idée d’échange contre des terroristes palestiniens. Son argument tenait en une formule claire : en temps de guerre, libérer des prisonniers ennemis, c’est renforcer leur camp et donc mettre en péril la collectivité tout entière. Même l’exigence suprême du Pidyon Chevouyim – ce commandement de racheter les captifs que nos Sages considèrent comme l’une des plus hautes Mitsvot, car il touche à la vie elle-même, à la dignité et à la liberté d’un Juif prisonnier – ne pouvait, selon lui, faire oublier la responsabilité de ne pas aggraver la menace de guerre par des concessions.
Pourtant, cette Mitsva elle-même est déjà limitée par la loi. La Michna interdit en effet de payer une rançon supérieure à la « valeur » du captif, fixée symboliquement à un cinquième, afin de ne pas encourager les ravisseurs à multiplier les prises d’otages. Mais que faire quand la vie du captif est en danger direct ? Alors un autre commandement s’impose : « Lo ta’amod ‘al dam ré’ékha » — ne reste pas indifférent au sang de ton frère. L’élan humain poussant à sauver des vies, coûte que coûte, trouve ici une légitimité incontournable.
Et pourtant, un principe tout aussi implacable, hérité du Talmud, se dresse face à lui : dama didakh soumak tefé — ton sang serait-il plus rouge que celui d’un autre ? Peut-on sauver une vie au prix d’en exposer d’autres ? Cette tension explique pourquoi chaque décision, loin d’être mécanique, devient un dramatique champ de bataille moral.
Quelques années plus tard, lors de l’affaire d’Entebbe en 1977, le Rav Ovadia Yossef pencha, avec d’autres grands décisionnaires, pour la possibilité d’un échange, si c’était la seule voie pour sauver des vies. L’opération militaire victorieuse rendit cette option inutile, mais sa position demeure un rappel fort : l’urgence du sauvetage immédiat prend parfois le pas sur toutes les autres considérations.
Ces dilemmes traversent tragiquement l’histoire juive. Au XIIIᵉ siècle, le Maharam de Rothenbourg, l’un des plus grands maîtres de Torah de son temps, préféra mourir en captivité plutôt que de laisser les Juifs allemands payer une rançon démesurée, conscient qu’un tel précédent exposerait d’autres rabbins à la même menace. À l’inverse, le Talmud rapporte que Rabbi Yehochoua ben ‘Hanania accepta de payer une somme bien au-delà de la « valeur » fixée, afin de libérer un jeune garçon dont il avait pressenti la grandeur spirituelle – et qui devint effectivement un maître pour tout le peuple d’Israël.
Ainsi, autour de l’affaire de la libération du Rav Yits’hak Hutner se révélèrent toutes ces tensions : l’impératif sacré de sauver, la limite de ne pas ouvrir de brèches irréparables, la légitimité de protéger une vie en danger immédiat, et la crainte de mettre d’autres vies en péril. Entre ces impératifs, il n’existe pas de réponse simple. Chaque époque, chaque situation force à reconsidérer l’ordre des priorités, et chaque décision laisse une empreinte durable dans l’histoire.
Le Rav Hutner confia plus tard qu’après sa libération, il resta marqué à jamais dans son être intérieur. On comprend aisément qu’après trois semaines passées dans des conditions éprouvantes, tant physiques que psychologiques, il en ait gardé des cicatrices profondes. Mais il laissait aussi entendre que ce n’était pas seulement la détention qui avait continué à le hanter : c’était également le prix payé pour sa libération, une charge morale qui ne le quitta plus jusqu’à la fin de sa vie.
Je ne peux conclure cette réflexion qu’en reprenant la prière traditionnelle :
Que l’Éternel, libérateur d’Israël, rompe les chaînes des captifs et les ramène sains et saufs dans la joie de leurs demeures. Qu’Il essuie les larmes de tout visage, relève les cœurs brisés et restaure la paix dans les remparts de Sion et de Jérusalem. Et que, de la nuit de l’angoisse, jaillisse bientôt l’aurore du salut, afin que toute chair voie que l’Éternel est Roi à jamais.