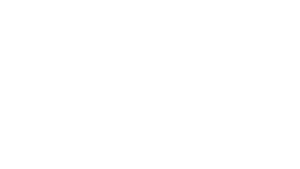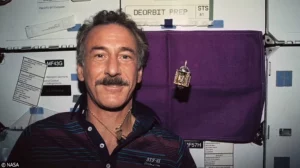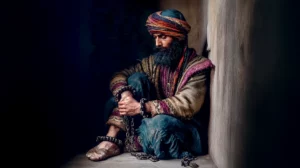Des origines légendaires
L’histoire des Juifs de Djerba remonte, selon les traditions orales, à des temps très anciens.
Celles-ci rapportent que les Juifs installés sur l’île, à l’exception des kohanim, seraient issus de la tribu de Zevouloun. Selon l’opinion la plus répandue, cette tribu, dès son installation en Erets Israël, s’empara de tout le territoire des Sidoniens (peuple cananéen vivant au Liban). Elle réalisait ainsi réalisait la bénédiction ultime de Ya’akov à son fils : « Zevouloun habitera sur le rivage des mers ; il sera sur le rivage des navires, et son héritage s’étendra jusqu’à Sidon » (Beréchith/ Genèse 49,13). Certains membres de cette tribu de Zevouloun auraient par la suite atteint l’Afrique du Nord, dans le sillage de l’expansion phénicienne, dont Sidon étaient une métropole. On sait en effet que les Phéniciens fondèrent, dès le IXe siècle avant l’ère actuelle, la ville de Qart-‘Hadachath, c’est-à-dire Carthage, près de l’actuelle Tunis.
Selon l’hypothèse du Rav Chaoul Cohen (rabbin de Djerba, décédé en 1848 et auteur du Lé’hem Biqourim), il est plausible que des Juifs de Djerba soient arrivés sur l’île à l’époque où Nabuchodonosor détruisit Jérusalem. Ses alliés phéniciens, en route vers leurs colonies de la péninsule ibérique, auraient emmené avec eux des Juifs, qui s’installèrent dans leur implantation de Djerba. De fait, selon la tradition de la communauté juive locale, un groupe de prêtres membres de la famille de Yedaya, fuyant Jérusalem, fonda une communauté juive à Djerba, immédiatement après la destruction du Premier Temple : ils y fondirent une localité et y édifièrent une synagogue. Selon cette tradition, ils auraient même emporté une porte du Temple détruit. C’est pourquoi leur communauté fut nommée Ha-Déléth (la porte), plus tard déformée en Ha-Degheth, nom du petit quartier juif de Djerba. Cette fameuse porte, conservée dans la synagogue de la Ghriba, a fait de ce lieu un site de pèlerinage.
Fait intéressant, certains kohanim djerbiens, voire tunisois, portent le nom de Cohen-Abrich depuis de très nombreuses générations. Ils expliquent que Abrich est l’acrostiche de “Ani Ben Rabbi Yichmaël”, je suis fils de Rabbi Yichmaël, l’illustre grand-prêtre de Jérusalem.
L’organisation géographique de la communauté
La communauté juive de Djerba s’est traditionnellement répartie sur l’île entre deux villages distincts et indépendants l’un de l’autre :
- Hara Kabira (« le grand quartier ») près du port sud de l’île, où selon la tradition vivent les descendants de la tribu de Zévouloun arrivés au temps du roi Salomon
- Hara Saghira (« le petit quartier »), situé à environ 7 kilomètres, habité principalement par des kohanim qui, selon la tradition, sont arrivés après la destruction du Premier Temple.
Au fil des années, ces groupes se sont mêlés, mais il s’agissait donc à l’origine de deux communautés distinctes.
Le Rav Eliahou Birnbaum, lors de sa visite à Djerba en 2008, entreprit d’examiner les traditions relatives au grand nombre de kohanim présents à Djerba, et celles-ci lui sont parues véridiques. Il arrivait fréquemment que les synagogues fussent remplies de kohanim, au point qu’il n’y ait personne pour monter à la Torah en tant que simple Israël, ni même un seul Israël pour donner comme il est d’usage la lecture aux kohanim, lors de la bénédiction sacerdotale. Parfois, lorsque ils bénissaient le peuple, il ne restait plus d’assemblée pour recevoir la bénédiction. Dans ce cas, la coutume voulait que les kohanim ne se tournent pas vers l’assistance, mais qu’ils continuent à élever leurs mains en direction de l’Arche sainte, afin de bénir l’ensemble du peuple travaillant aux champs, ainsi que tous les Juifs se trouvant en dehors de la synagogue.
En revanche, il n’y eut jamais de Lévites parmi les Juifs de l’île. Là encore, une légende transmise par les Juifs de Djerba et par les traditions de la communauté, vient rendre compte de cette situation étonnante. Lorsque Néhémie et Ezra le Scribe constatèrent l’absence de Lévites parmi les exilés qui remontaient avec eux vers la Terre d’Israël pour reconstruire le Second Temple (Ezra 8, 15), Ezra se serait adressé aux Lévites de Djerba pour les conjura de se joindre à lui. Mais ceux-ci refusèrent. Alors, nous raconte la tradition orale, Ezra les maudit, déclarant qu’ils ne verraient pas la fin de l’année sur l’île. Les Lévites, de leur côté, le maudirent à leur tour, disant qu’il n’aurait pas le mérite d’être enterré en Terre d’Israël. Et les deux malédictions, nous dit-on, se seraient réalisées…
La réalité semble en effet confirmer la véracité de cette légende : depuis des siècles et jusqu’à ce jour, on ne trouve aucun Lévite à Djerba. Les Lévites se sont toujours abstenus de s’y établir, redoutant que la malédiction d’Ezra ne continue de peser sur toute famille lévitique qui voudrait s’y installer. Il est vrai qu’un certain Mr Levi, originaire de Tunis, dirigeait l’imprimerie juive locale, mais il prenait garde de ne pas y séjourner 12 mois consécutifs…
L’Histoire de la communauté
Les premières preuves concrètes de la présence juive à Djerba datent du XIe siècle. Une lettre marchande de la Gueniza du Caire, datée de 1030, mentionne un Juif nommé Abū al-Faraj al-Jerbī (le Djerbien) vivant à Kairouan et commerçant avec les terres orientales.
Si certains Juifs étaient très riches, la plupart travaillaient à la sueur de leur front, sur les marchés, dans l’orfèvrerie ou l’artisanat. L’une des spécialités des Juifs de l’Île étaient la fabrication de lourds châles de prière en laine, appelés Türkische Talettim. Si les relations avec la population autochtone étaient relativement calme, l’histoire des Juifs de Djerba comprend trois persécutions majeures: au XIIe siècle sous les Almohades, en 1519 sous les Espagnols, et en 1943 sous l’occupation nazie.
En 1878, alors que la France s’est imposée comme puissance coloniale en Tunisie, l’Alliance Israélite Universelle décide d’ouvrir à Djerba une école juive d’instruction générale. Mais les sages de Djerba se dressent contre l’intrusion de l’Alliance, et promulguent un décret rabbinique interdisant l’ouverture d’une telle école.
L’établissement restera désert et ne sera finalement fréquenté que par des musulmans. Les Juifs de Djerba, en effet, refusent le processus de modernisation : ils ne souhaitent pas rompre avec l’ancien monde où la religion occupe une place centrale. Ils comprennent que l’apprentissage de la langue française n’est pas seulement un outil d’intégration économique dans la société moderne, mais qu’il peut également servir de passerelle vers la population non juive et devenir un catalyseur d’assimilation tant sociale que religieuse. À la croisée des vents du progrès et des murmures de la tradition, les Juifs de Djerba élevèrent donc un rempart de foi inébranlable. Refusant l’appel séduisant de la modernité, ils choisirent la lumière ancienne de la Torah. Par ce choix audacieux, Djerba devint ainsi un sanctuaire vivant où le temps semble s’être arrêté, dans la fidélité à un héritage immémorial.
Cette communauté a vu naître et grandir de très grands maîtres de la Torah comme Rabbi Moché Khalfon Hacohen (1874-1950), Rabbi ‘Haïm ‘Houri (1885-1955) ou encore Rabbi ‘Haï ‘Houïta Hacohen (1901-1959) et bien d’autres encore…
Mais les temps ont changé et la communauté djerbienne ne cesse de se réduire. Si elle n’a jamais compté plus de 4 500 membres, sa réputation et son influence étaient grandes dans toute l’Afrique du Nord, en raison de son exceptionnelle antiquité et de la force de ses traditions. Mais à partir du milieu du XXe siècle, elle s’est vue touchée, comme d’autres communautés d’Afrique du Nord, par un net et inexorable déclin démographique.
Plusieurs facteurs ont contribué à l’exode des Juifs tunisiens : la création d’Israël en 1948 et les guerres israélo-arabes, qui ont provoqué une vague de fond anti-sioniste dans le monde arabe. Puis la crise de Bizerte en 1961, où la rupture des relations franco-tunisiennes pousse 4 500 juifs à partir, avec le droit d’emporter seulement un dinar par personne. Puis encore et peut-être surtout la guerre des Six Jours, en 1967.
La communauté djerbienne a été récemment douloureusement marquée par deux attentats majeurs : Le 11 avril 2002, un attentat-suicide orchestré par Al-Qaïda a frappé la synagogue de la Ghriba. Un camion-citerne chargé d’explosifs a explosé devant l’édifice, tuant 19 personnes. Le 9 mai 2023, une nouvelle tragédie a endeuillé la communauté lors du pèlerinage annuel. Un gendarme tunisien a ouvert le feu près de la synagogue, tuant quatre personnes dont deux fidèles juifs.
La population juive de Tunisie, estimée à 100 000 individus avant l’indépendance en 1956, avait chuté à 1 500 en 2017. À Djerba spécifiquement, alors qu’elle comptait environ 4 000 personnes dans les années 1930, la communauté varie désormais de 700 à 1 000 personnes ces dernières années.
La diaspora tunisienne s’est principalement dirigée vers deux destinations : Israël et la France. Alors qu’au même moment, contrairement aux attentes sionistes, la grande majorité des Juifs d’Algérie (135 000 personnes) a choisi la France, suscitant une vive déception en Israël.
La communauté juive d’origine djerbienne à Paris est organisée notamment autour de l’Amicale des Juifs de Djerba (AJJ), fondée en 1986 par le Dr Gabriel Kabla.
Cette association joue un rôle essentiel pour les Djerbiens immigrés en France, en leur permettant de conserver des liens étroits entre eux ainsi qu’avec leurs coutumes et rites. Une école a même été fondée : l’École Yechiva Torah Werahamim, dans le 19e arrondissement de Paris, qui accueille plusieurs centaines d’élèves, et propose, avec grand succès, un enseignement alliant études religieuses et programmes scolaires classiques.
En Israël, le judaïsme djerbien regroupe environ 50 000 personnes, principalement installées à Natanya, Achdod et Benei Brak. Les institutions de la Yéchiva Kissé Ra’hamim, fondée en 1962 en Tunisie par Rabbi Matsliah Mazouz, furent transférées en Israël après l’assassinat de leur fondateur à Tunis par un terroriste, en 1971. Son fils Rabbi Meïr Mazouz (décédé durant cette année 5785/2025), fondera la nouvelle institution à Benei Brak en 1971. Celle-ci compte aujourd’hui plus de 1000 élèves, dans huit antennes différentes. Cette yéchiva est un centre majeur d’étude de la Torah et de préservation des traditions djerbiennes.
Des coutumes préservées
Le judaïsme djerbien se caractérise par des coutumes particulières et des usages uniques, différents des autres communautés juives, et dont l’origine pourrait remonter directement à la Terre Sainte.
L’un des usages les plus remarquables, rapporté par Rabbi Moché ‘Halfon Hacohen dans son Berith Kehouna, est celui de la sonnerie du chofar la veille du Chabbath. Cette cérémonie est conçue comme une préparation à la venue du Messie. Ainsi, à la veille du Chabbath, le Juif chargé de la sonnerie du chofar se tient sur le toit d’une
des maisons les plus hautes du quartier juif Hara Kabira. Il fait retentir neuf sons, deux fois dans les quatre directions du monde, afin d’annoncer l’arrivée du Chabbath et signifier l’interdiction de toute activité profane, et une dernière enjoignant d’allumer les lumières du Chabbath.
Autre coutume particulière : lors du Seder de Pessa’h, on récite le « Kiddouch long » composé par Rabbi Saadia Gaon et non le Kiddouch traditionnel.
À trois occasions au cours de l’année, la communauté lit les Haftaroth (passages extraits des Prophètes, lus après la lecture hebdomadaire de la Torah) de Chemoth, Bo et Bechala’h selon un ordre différent de celui des autres rites d’Israël. On raconte à ce sujet que lorsque ces usages furent soumis à l’avis de Rabbi Yossef Karo, auteur du Choul’han ‘Aroukh, considéré comme une autorité suprême de la loi juive, il statua que, puisque la communauté de Djerba existait avant la destruction du Temple, il ne fallait rien modifier à ce qu’avaient fixé les Anciens.
À Djerba, la prière pour la pluie se fait le 7 Mar’hechwan, comme en Terre d’Israël, et non selon la saison solaire (le 5 décembre), ainsi que c’est la coutume en diaspora. On remarque aussi l’usage d’une variété spécifique du judéo-arabe tunisien, qui combine les dialectes arabes locaux et l’hébreu ancien.Il y a bien sûr aussi d’autres coutumes communes à tout le judaïsme tunisien comme la Sé’oudath Yithro ou fête des garçons, avec ses pigeons et petits gâteaux, souvenir d’une épidémie de diphtérie touchant principalement les garçons, qui s’étaient arrêtée durant la semaine où l’on lisait cette Paracha. Beaucoup se rappellent également le “bûcher de Haman“, où un épouvantail à son effigie est brûlé à Pourim ; ou la Bessissa de Roch ‘Hodech Nissan, lorsque le chef de famille remue un plat de céréales avec une clé, en demandant que la Providence divine nous ouvre les portes de l’abondance.
La maîtresse de maison allume à cette occasion une veilleuse où est déposé un bijou d’or, en souvenir de la pose de la première pierre du Temple, inauguré ce jour de l’année. Le mot hébreu Bassis, fondation, constitue d’ailleurs la racine du mot Bessissa.
La synagogue de la Ghriba : coeur spirituel de la communauté
On ne peut parler de coutumes djerbiennes sans s’attarder sur le pèlerinage de Lag ba’Omer dans la synagogue de la Ghriba.
La synagogue de la Ghriba constitue en effet le principal marqueur identitaire des Juifs de cette île singulière. Située à proximité de Hara Saghira, elle est considérée comme la plus ancienne synagogue de Tunisie, voire l’une des plus anciennes du monde. Comme nous l’avons déjà vu, la Ghriba aurait été fondée par des kohanim, prêtres réfugiés de Jérusalem, et contiendrait des restes du Temple de Salomon. Le mot arabe « Ghriba » signifie, selon certains, « la désolée », car elle seule fut épargnée lors d’une période où les Juifs furent chassés de la ville par les Arabes ; ceux-ci, toutefois, n’osèrent pas porter la main sur ce lieu saint. D’autres expliquent le mot “ Ghriba” comme miraculeux, en rapport avec des faits miraculeux qui s’y seraient déroulés.
L’architecture actuelle de l’édifice, constamment reconstruit et remanié, présente une abondante décoration, avec des panneaux de céramiques et des plafonds en bois décoré rappelant l’art du XVIIIe siècle. En effet, les les Espagnols la détruisirent au XVIe siècle, lors de leur conquête de l’île. Elle fut cependant restaurée au même endroit, il y a près de deux siècles. La synagogue s’étend sur une immense surface de 10 500 m², et son architecture évoque les édifices du XIXe siècle.
La Ghriba fait l’objet d’un pèlerinage annuel majeur lors de Lag ba’Omer, le 33e jour du décompte de l’Omer. Les festivités débutent le 14 Iyar pour commémorer Rabbi Meïr Ba’al ha-Ness et se poursuivent jusqu’au 18 Iyar, en souvenir de Rabbi Chimon bar Yo’haï.
Au centre de la célébration de cette Hilloula se dresse la Ménorah de Rabbi Chim’on Bar Yo’haï, conçue comme une grande et impressionnante Ménorah à sept branches, façonnée en argent et en or. Le soir de la Hilloula, le candélabre est placé sur une charrette spécialement aménagée, ornée de fleurs et d’étoffes colorées, et illuminée pour conférer une atmosphère festive. La Ménorah est transportée depuis la synagogue jusqu’au quartier juif de Hara Saghira, puis ramenée à la synagogue lors d’une procession rythmée par la musique de fanfares et le chant de poésies liturgiques.
Si dans le passé les participants venaient de toute la Tunisie et de pays voisins d’Afrique du Nord, ce sont aujourd’hui des milliers de participants, parfois même non juifs, qui font le voyage de tout le pays mais aussi de France et d’Israël pour prier, donner de la Tsédaqa, et s’imprégner de l’héritage de Rabbi Chimon bar Yo’haï, le grand maître de la Kabbale.
La communauté juive de Djerba demeure ainsi, à travers son atmosphère enchanteresse et comme hors du temps, un témoignage vivant de la richesse du judaïsme maghrébin ; elle offre aussi un exemple incomparable de la capacité de résistance spirituelle d’une minorité souvent persécutée, conservant son manteau de dignité, sans fléchir même aujourd’hui face aux défis de l’histoire contemporaine.