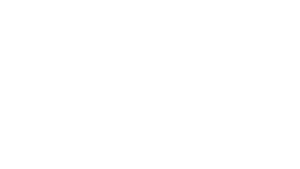I. Comprendre le wokisme : entre éveil et rigidité
Le terme Woke, issu de to wake up (se réveiller), désignait au départ un éveil face aux injustices[1] : racisme, sexisme, exclusions sociales. Mais cette conscience, d’abord salutaire, s’est peu à peu figée en idéologie, jusqu’à devenir un marqueur identitaire clivant. Le wokisme ne relève plus seulement de l’éthique : il vise à structurer désormais le débat public et à cristalliser les conflits.
Aux États-Unis, Donald Trump en a fait un ennemi déclaré. Lors de la convention CPAC en 2023[2], il promettait : « We will defeat the Woke » (« Nous vaincrons les Woke »), les désignant comme une menace civilisationnelle. En parallèle, le monde culturel s’imprègne largement de ses nouvelles normes. Cinéma, littérature, théâtre, humour, musique : tout semble aujourd’hui traversé par une exigence de prise de position. Un ami humoriste me confiait : « Mon spectacle fait rire, les salles sont pleines, mais on me reproche de ne pas porter de cause. » Faire rire ne suffit plus : il faut militer, dénoncer, s’engager. L’art devient vecteur idéologique, et la neutralité, autrefois perçue comme possibilité de distance critique, est jugée suspecte, voire complice ou même perverse.
Des enjeux longtemps marginaux sont devenus centraux. Ils orientent les récits, dictent les discours et imposent des choix. Le wokisme, dans sa forme actuelle, ne se limite plus à éveiller : il redéfinit les frontières du dicible, souvent au détriment de la nuance et du lien social.
II. La sagesse talmudique face à la modernité woke
Face à cette reconfiguration culturelle, que peut offrir la tradition juive ? Plus qu’un système de lois, elle est un regard, une grille de lecture du monde nourrie par des récits, des questionnements et une sagesse millénaire.
Les histoires de la Genèse, les controverses talmudiques, les réflexions de nos maîtres ont abordé, bien avant nous, les mécanismes de pouvoir, les passions collectives, les dérives idéologiques et les résistances. Ce regard ancien reste étonnamment pertinent.
Le Rav Bloch de la Yechiva de Telz, dans Chi’ourei Da’ath[3], distingue le corps et l’âme de l’étude : le premier, dans l’analyse technique des thèmes analysés ou souguioth ; la seconde, dans l’intégration de ces enseignements à notre vie. Cette distinction nous appelle à penser le monde à la lumière de la Torah, et la Torah à la lumière du monde. Le wokisme devient ainsi un objet d’étude : non pour juger, mais pour comprendre. Pour interroger les mutations du lien social, la centralité de la mémoire blessée, la tension entre justice et excès.
Se demander « que diraient nos maîtres ? », c’est préférer la complexité à la réaction, la profondeur à la posture. Et peut-être est-ce là notre véritable ‘hidouch : produire du sens nouveau, non en dépit du passé, mais grâce à lui.
III. Trois civilisations : la Genèse comme miroir de l’histoire
À travers les récits de la Genèse, la Torah propose une lecture profonde de l’évolution des structures sociales humaines, incarnée par trois civilisations fondatrices[4]. La génération du Déluge représente une société centrée sur l’individu, replié sur lui-même, indifférent à l’autre[5]. Celle de la Tour de Babel incarne l’excès inverse : un projet collectif uniformisant, qui écrase toute singularité[6]. Puis surgit une troisième forme, plus déroutante encore : Sodome et Gomorrhe, société apparemment structurée, mais moralement pervertie. Nombre de commentateurs discernent une continuité entre ces trois modèles, une progression.
1. La génération du déluge (Béréchith 6)
Dieu voit que “la terre était remplie de ‘hamas’” – violence, vol, viol, meurtre, idolâtrie[7]. L’humanité s’est construite sur la pulsion, l’égoïsme, l’absence de regard sur l’autre. Pas de société, pas de communauté. Chacun vit pour lui, au mépris du lien fondateur. C’est la destruction.
2. La tour de Babel (Béréchith 11)
Face à l’anarchie, la réponse proposée est l’uniformité, ce que l’historien allemand Sebastian Haffner a pu désigner, parlant du nazisme, comme “encamaradement” : une seule langue, une seule pensée. Nimrod, instigateur de la tour de Babel, cherche à structurer l’humanité autour d’un projet commun. En apparence, l’initiative semble noble ; en réalité, elle cache une logique totalitaire. Le Natsiv, rabbi Naftali Tsvi Berlin, directeur de la célèbre Yechiva de Volozhyn, explique que la tour servait de mirador[8] : toute divergence y était repérée, toute dissidence, réprimée. L’unité se transforme en oppression. L’individu n’existe plus que comme élément du corps collectif.
C’est alors qu’émerge une voix dissonante. Un homme ose s’opposer à cette tyrannie de l’uniforme : Avraham. Par son refus de se soumettre au roi Nimrod, il célèbre la singularité de chaque être humain. Il inaugure ainsi une autre voie, fondée non sur la fusion des volontés, mais sur l’alliance libre entre D.ieu et l’homme. Ce geste inaugural jette les fondations d’un destin collectif singulier : celui du peuple d’Israël.
3. Sodome et Gomorrhe : entre caricature et critique
C’est cette troisième société qui retient particulièrement l’attention. Rachi[9] explique que les habitants de Sodome et Gomorrhe sont des rescapés de la tour de Babel — preuve que nous restons dans la continuité de l’évolution de l’humanité. À première vue, la société sodomite semble structurée : elle possède ses lois, ses juges, sa cité. Mais sous cette apparente stabilité, ses fondations sont profondément corrompues. Derrière la façade du droit, c’est l’inhumanité qui domine.
Le Talmud[10] décrit un monde glaçant, où l’on tue avec politesse : un pauvre y meurt, non sous les coups, mais par une cruauté légale. Chacun lui donne une pièce, mais personne ne lui vend de pain. La justice devient instrument d’exclusion. La loi, un outil de destruction.
Et pourtant, ce qui frappe, c’est la prière d’Avraham pour tenter de sauver cette société. Pourquoi Avraham notre père chercherait-il à préserver un système aussi pervers ? Quelle valeur trouve-t-il encore dans une ville gangrenée par l’injustice ? La question est dérangeante — et essentielle.
IV. L’éthique de Sodome : quand la loi tue la bonté
Une définition centrale de Sodome, selon nos Sages, est l’absence de générosité. La Michna dans Pirkei Avoth[11]évoque l’attitude suivante : « Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi ». Cela peut sembler neutre, voire équilibré même respectueux de l’autre. Pourtant, plusieurs maîtres y voient la misa ou mesure de Sodome.
Car lorsque je peux aider sans préjudice, mais choisis de m’en abstenir par principe ou indifférence, je ne suis plus neutre. Je participe à une logique pervertie, celle d’un monde où le droit est dissocié de l’éthique, et où l’indifférence devient la norme.
Le Talmud rejette explicitement cette posture à travers un principe devenu fondamental : כופין על מידת סדום — « On contraint à ne pas se comporter selon la mesure de Sodome[12] ». Même si la loi autorise un refus d’assistance, si pourtant celui-ci relève d’un égoïsme stérile, la société peut contraindre à agir autrement. Lorsque la légalité devient prétexte à l’inhumanité, le tribunal a le devoir d’intervenir. Ce principe affirme qu’en judaïsme, la justice dépasse la stricte légalité : elle implique une exigence morale envers l’autre.
À Sodome, tout est encadré, mais rien n’est juste. La loi y règne, mais au service d’un cruel égoïsme. Sous couvert de légalité, on commet les pires horreurs. Les Sages rapportent qu’un juge ordonna un jour à un homme ayant frappé une femme enceinte — provoquant une fausse couche — de vivre avec elle jusqu’à ce qu’elle retombe enceinte, pour « rembourser » l’enfant perdu. La justice devient caricature.
Le Talmud[13] évoque aussi le sinistre lit de Procuste. Si un étranger venait dormir à Sodome, on lui imposait un lit volontairement inadapté : trop court ou trop long. On tirait ou mutilait ses membres pour l’y faire entrer.
Même l’aumône était pervertie. Lorsqu’un mendiant arrivait, chaque habitant lui donnait une pièce marquée de son nom, mais tous s’étaient entendus pour interdire aux commerçants de lui vendre de quoi manger. Le pauvre mourait de faim, et chacun récupérait sa pièce sur son cadavre. Une jeune fille, coupable d’avoir nourri un affamé, fut tuée — piquée à mort par des abeilles.
Et pourtant, tout se faisait selon la “loi”. Telle est la perversion de Sodome : une société où la légalité masque l’inhumanité, où la structure remplace la morale, et où l’ordre devient le masque de la cruauté.
V. Pourquoi Abraham veut-il sauver Sodome ?
Ce qui trouble, c’est qu’Avraham, notre père, plaide en faveur de cette société. Lorsque Dieu lui annonce la destruction imminente de Sodome, il réagit avec une audace rare. Et pourtant, il était resté silencieux quand Dieu lui avait révélé que sa propre descendance serait asservie dans un pays étranger — acceptant ce destin comme une fatalité. Mais face à Sodome, il ose contester, argumenter, supplier : « Et s’il y avait cinquante justes ? Quarante ? Trente ? Vingt ? Dix ?[14] »
Pourquoi une telle insistance pour sauver une ville aussi perverse ? Qu’a-t-il perçu de digne dans une société si dévoyée ?
Et Dieu tranche : « Il n’y a rien à sauver. »
Faudra-t-il donc que Dieu lui-même le dise pour qu’Avraham accepte cette réalité ? Sans cette parole divine, aurait-il continué à croire qu’un reste de justice pouvait encore racheter Sodome ?
VI. Wokisme et Sodome : la lecture du Maharal
Il est facile, pour nous, d’identifier les travers d’une société lorsque les Sages de notre tradition nous en ont déjà dévoilé les mécanismes profonds, souvent à travers des images fortes et caricaturales. Mais comme le rappelle le Maharal de Prague[15], la description de Sodome dans le Talmud relève de la parabole. Ce que les Sages dévoilent après coup n’était pas aussi clair aux yeux d’Avraham — si ce n’est dans la lumière que D.ieu lui en donne.
Peut-être Avraham voyait-il en Sodome une société enfin structurée autour de valeurs apparemment humanistes. Ce n’est sans doute pas un hasard si Loth, son élève et neveu, choisit de s’y établir. À ce moment-là, rien ne semblait évident : cette ville pouvait encore séduire une conscience éthique, sensible à la morale et à la justice. C’est le dévoilement divin qui lève le voile sur ce qui se cache derrière les apparences.
Les habitants de Sodome se croyaient civilisés. Ils donnaient l’aumône, ils parlaient de valeurs, d’humanité, de justice sociale. À première vue, ils agissaient selon les normes du bien. Mais les Sages révèlent la vérité de leurs actes : ils gravaient leur nom sur les pièces données au mendiant afin de les récupérer une fois celui-ci mort de faim. Le geste de générosité n’était qu’un masque. Ce qu’ils recherchaient, ce n’était pas le bien du pauvre, mais la reconnaissance. Ils préféraient récupérer leur pièce — une part d’eux-mêmes — plutôt que voir vivre celui qui la recevait. Ce qui les animait n’était pas la bonté, mais l’image, la posture d’eux-mêmes en bienfaiteurs. Ils voulaient être vus comme humanistes, être admirés et applaudis.
Ils redoutaient les étrangers. Il fallait vite les faire entrer dans les cases de leur combat, les contraindre à adopter leur vision soi-disant humaniste. À coups de violence, ils les forçaient à se conformer — quitte à les allonger sur des lits inadaptés, tirant ou sectionnant leurs membres, comme dans le sinistre lit de Procuste. Aucune place pour la critique : toute remise en question de leur combat était perçue comme une menace. Ils ne voulaient pas dialoguer, mais convertir. De force, si nécessaire.
Ils créent des règles et lois ‘’humanistes’’ qui n’en sont qu’une caricature.
VII. Une vigilance juive
La Torah ne rejette pas les combats portés par le wokisme — elle les précède. Elle impose de prendre à cœur la souffrance du faible, du rejeté, du marginal. Il est écrit : « N’insulte pas un sourd, et ne mets pas d’obstacle devant un aveugle » (Vayikra 19:14). Elle exige un respect absolu envers le pauvre, le converti, l’étranger. Elle dénonce la bonne conscience du dominant.
Mais cet engagement ne peut se réduire à un simple dispositif institutionnel ou identitaire. Ce n’est pas parce qu’on agit « correctement » qu’on peut s’en réclamer comme d’un titre moral. La Torah demande plus : que ce souci de l’autre ne soit pas un réflexe social, mais une préoccupation sincère, enracinée dans la profondeur de l’âme.
Dès lors que ce combat, cet éveil, se transforme en identité de groupe, l’individu disparaît. Il n’est plus réellement pris en compte par ces pseudo-humanistes : ce n’est plus l’humain qui importe, mais l’appartenance, le positionnement social. Le militantisme devient un drapeau, une étiquette, un camp à défendre. Jusqu’à même pervertir les causes du combat.
Ainsi, certaines féministes, autrefois engagées pour la dignité et le respect des femmes, peuvent glisser vers des postures visant à écraser les hommes. Certains militants queer, ou affiliés à des causes similaires, en viennent à soutenir des mouvements islamistes radicaux, dans une logique d’alliance intersectionnelle où toute cohérence disparaît. Les amalgames se multiplient, les contradictions s’effacent derrière une seule exigence : appartenir au bon camp, celui de la totalité du bien.
Dans ce brouhaha militant, l’individu, la personne humaine, n’est plus la véritable préoccupation. Or, c’est précisément ce souci-là — la reconnaissance de l’autre dans sa singularité — qui constitue la valeur authentiquement vertueuse, celle que la Torah promeut et exige.
[1] Voir l’article « Woke » sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Woke
[2] Discours de Donald Trump à la CPAC 2023, 4 mars 2023 : https://archive.org/details/CSPAN_20230304_223000_Former_Pres._Trump_Speaks_at_CPAC?
[3] Yossef Yéhouda Leib Bloch, Chi’ourei Da’ath, chapitre « Darka chel Torah » (La voie de la Torah)
[4] Voir Akiva Zyzek, Je suis mais ça ira, éd. Gilbert Werndorfer, sujet largement développé en profondeur dans la première partie : « Vivre en harmonie ou l’utopie de la vie collective », : https://www.amazon.fr/dp/2959004760
[5] Voir Talmud, traité Sanhédrin 57a, ainsi que le commentaire de Rachi sur Béréchith 6,11.
La génération du Déluge se distinguait par des comportements profondément immoraux, marqués notamment par le vol et la violence sexuelle. À cela s’ajoutait l’idolâtrie, formant un tableau de corruption généralisée et de mépris absolu pour autrui. L’autre n’avait aucune valeur à leurs yeux. Livrés à leurs pulsions, ils agissaient sans la moindre considération pour le bien-être de ceux qui les entouraient. Leur mode de vie était entièrement centré sur eux-mêmes, insensible aux conséquences de leurs actes sur la société.
[6] Voir le commentaire du Netsiv (Rav Naftali Tsvi Berlin), Hé’amek Davar sur Béréchith, chap. 11.
[7] Voir Talmud, traité Sanhédrin 57a, ainsi que le commentaire de Rachi sur Béréchith 6,11.
[8] Voir le commentaire du Netsiv (Rav Naftali Tsvi Berlin), Hé’amek Davar sur Béréchith, chap. 11 verset 4 intitulé : ‘’Une tour dont le sommet atteigne le ciel’’.
[9] Commentaire de Rachi, Béréchith chapitre 19 verset 20 intitulé : ‘’Cette ville-là est proche’’.
[10] Sanhédrin 109b
[11] Pirkei Avoth, Chapitre 5, Michna 10.
[12] Baba Bathra 12b
[13] Sanhédrin 109b
[14] Béréchith chapitre 18, versets 23-25
[15] Voir Maharal de Prague, Hidouchei Aggadoth sur le traité Sanhédrin 109b.