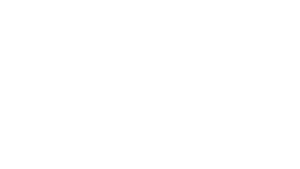Le 16 mars 2025, en pleine guerre contre le Hamas, Benjamin Netanyahou tente de se débarrasser de Ronen Bar, le patron du Shin Bet (le service de sécurité intérieure israélien). La décision fait l’effet d’un coup de tonnerre. Officiellement, il s’agirait d’un « manque de confiance ». Officieusement, Bar menait une enquête gênante sur des proches du Premier ministre, soupçonnés d’avoir touché de l’argent du Qatar en pleine guerre. Cinq jours plus tard, le 21 mars, la Cour suprême israélienne (le Bagats) gèle le processus, en dénonçant de sérieuses irrégularités et surtout un évident conflit d’intérêts.
Ce duel entre le gouvernement (pouvoir exécutif) et la justice (pouvoir judiciaire), en plein chaos sécuritaire, ravive une vieille blessure institutionnelle. En effet, bien avant le séisme du 7 octobre, Israël traversait déjà une crise, non pas militaire, mais morale : que vaut une loi, si elle ne garantit pas un minimum de justice ?
Souvenons-nous : portée par le gouvernement, une réforme judiciaire visant à affaiblir les pouvoirs de la Cour suprême avait divisé le pays. Pour ses partisans, elle venait rétablir l’équilibre : redonner toute sa souveraineté à la Knesset (pouvoir législatif), donc au peuple. Dans une démocratie, la majorité n’est-elle pas censée trancher ? Si une loi est adoptée par des élus, pourquoi quelques juges non élus pourraient-ils la bloquer, simplement parce qu’ils la jugent « déraisonnable » ?
Mais pour beaucoup d’Israéliens, cette réforme sonnait comme une alerte rouge. Car une majorité n’a pas toujours raison. Elle peut exclure, discriminer, écraser. L’histoire abonde de lois votées dans les règles… et pourtant injustes. C’est pour prévenir ces dérives que les démocraties s’entourent de garde-fous : des institutions indépendantes, qui ne contestent pas la démocratie, mais qui la protègent de ses propres excès.
Cette réforme sonne comme une alarme pour beaucoup d’Israéliens dans l’idée que la majorité n’a pas toujours raison : elle peut exclure, discriminer, écraser.
Mais alors, qui définit la justice ? Les juges, prudents mais non élus, les intellectuels, les militants, les minorités ? Et au nom de quel principe une poignée d’individus aurait-elle le droit de dire non à une volonté populaire affirmée ? Est-ce par leurs compétences ? Leur éthique ? Ou simplement le rôle qu’ils occupent dans l’architecture démocratique ?
Le cœur du débat se situe donc entre la légitimité du nombre et celle des principes, entre la souveraineté populaire et les limites morales, entre la loi écrite et la justice ressentie. Cette tension, placée dans un autre cadre, se retrouve d’ailleurs au sein même de la tradition juive.
Sans vouloir tracer des parallèles trop appuyés puisque les époques, les contextes, les acteurs sont évidemment très différents, je souligne un passage talmudique dans la tradition juive, un peu surprenant, à propos du roi David. Il permet de faire une ouverture sur la place du pouvoir et des contre-pouvoirs. Un épisode étonnant, presque anecdotique, quoique riche de sens, autour de la figure du roi David.
En pleine bataille décisive, le roi David désire boire de l’eau de Bethlehem
À cette époque, David, récemment couronné successeur de Saül, peinait encore à asseoir son autorité sur les tribus d’Israël. Les Philistins, ennemis redoutables installés sur la côte sud, poursuivaient leur offensive. C’est d’ailleurs dans ce contexte de tensions guerrières que David avait acquis sa renommée en terrassant Goliath, le géant philistin, un exploit miraculeux qui lui valut la main de la princesse Michal, avant même de devenir roi.
Devenu roi, David mène des campagnes pour libérer les territoires occupés. Sa victoire décisive dans la plaine d’Émèk Refaïm marque l’adhésion du peuple à sa légitimité royale. Le Talmud évoque cet épisode avec mystère, comme si la force militaire ne suffisait pas à expliquer cette reconnaissance.
Les Philistins, retranchés dans la plaine d’Émèk Refaïm, coupent la route reliant Jérusalem à Bethléhem. Reclus dans Jérusalem, récemment conquise aux Jébuséens, David subit le siège. Pris dans l’étau, il exprime un souhait pour le moins étonnant au vs de la situation et à la bataille imminente qui se prépare : boire l’eau du puits situé à la porte de Bethléhem, désormais inaccessible. Le Deuxième Livre de Samuel rapporte ses paroles :
« David eut un désir et dit : « Ah ! Si seulement on pouvait me faire boire de l’eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ! » » (Samuel II 23, 15).
Cette scène étonnante servira d’ailleurs de point de départ à une réflexion talmudique dans le traité Baba Kama sur les dilemmes moraux et halakhiques face à un danger de mort immédiat.
À l’écoute de ce souhait, trois de ses guerriers traversent le camp philistin, puisent de l’eau à la citerne de Bethléem et la rapportent à David.
De prime abord, le verset étonne par son contexte : en pleine mobilisation militaire, alors que l’urgence est critique et que la ville est assiégée, David formule un désir personnel, boire l’eau de la citerne de Bethléem, située juste devant la porte de la ville, donc en plein territoire ennemi.
Et pourtant, ses hommes obéissent. Ils s’introduisent derrière les lignes adverses, bravent le danger, et reviennent avec l’eau destinée à leur roi.
La suite de l’histoire est également déroutante : David refuse de la boire et il la verse devant Dieu, comme une offrande.
Des années plus tard, à l’approche de sa mort, David prendra le temps de mentionner et honorer ces guerriers, auteurs de cet acte de bravoure, dans les dernières paroles qu’il laissera. Cela montre bien l’importance de cette scène dans l’histoire du règne de David.
David le « roi philosophe »
Cette scène, en apparence anodine, revêt selon le Talmud une portée bien plus profonde. Le « désir » d’eau exprimé par David n’est pas un caprice, mais une parabole : l’eau symbolise l’enseignement de la Torah, et la porte de Bethléem, le siège du Sanhédrin, le tribunal suprême.
David faisait face à un dilemme juridique : les Philistins s’étaient cachés dans des meules de foin appartenant à des particuliers juifs. La stratégie la plus efficace aurait été d’y mettre le feu pour les en déloger. Mais pouvait-il, pour sauver des vies, porter atteinte à la propriété privée ?
Il souhaitait consulter le Sanhédrin — ce que symbolise son « désir d’eau de la porte de Bethléem », c’est-à-dire son besoin de clarté juridique et morale. Les Sages répondirent : « Il est interdit de sauver sa vie aux dépens des biens d’autrui. Mais toi, en tant que roi, tu as le droit de tout raser sur ton passage. »
David refusa pourtant d’user de cette permission. Il versa l’eau en offrande à Dieu, choisissant de ne pas exercer ce droit royal.
La réponse du Sanhédrin met en lumière un point fondamental : le roi détient un pouvoir qui dépasse sa juridiction.
Cette différence apparaît clairement sur un sujet sensible : la peine de mort. La Torah la prévoit pour 36 interdits graves, à appliquer par le tribunal rabbinique. Mais les conditions sont si strictes qu’elle devient pratiquement inapplicable. Selon Maïmonide, il faut un avertissement explicite juste avant l’acte, l’aveu de l’interdit par l’accusé, sa volonté de le transgresser, tout cela devant témoins, et l’acte doit suivre immédiatement. Sinon, la procédure est annulée.
Les Sages affirmaient qu’un Sanhédrin qui prononce une peine de mort tous les sept ans est déjà considéré comme « violent ». Rabbi Elazar ben Azaria parlait de 70 ans. Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon affirmaient que sous leur autorité, personne n’aurait jamais été exécuté.
Le roi, lui, n’est pas soumis aux mêmes règles. Selon Maïmonide, il peut, si nécessaire, exécuter un coupable sans preuves irréfutables, sans avertissement, voire sur un seul témoignage. Il peut agir dans l’urgence, éliminer des ennemis, imposer l’ordre, dissuader. Il a même le droit d’exposer les corps plusieurs jours pour impressionner.
En résumé, le rôle du Sanhédrin et celui du roi sont totalement différents. Le Sanhédrin incarne la morale de la Torah ; le roi, la force politique et la souveraineté.
Dans le refus de David de boire l’eau de Bethléem réside toute la subtilité de son exercice du pouvoir. Deux autorités coexistent — parfois en harmonie, parfois en tension : celle du roi et celle du Sanhédrin. Les Sages semblaient lui dire : « Pourquoi nous consulter ? Notre rôle est de répondre selon la loi. Mais toi, tu évolues dans un autre cadre. Tu es roi. »
Pourtant, David cherche à intégrer la loi du Sanhédrin dans sa gouvernance. Il incarne ainsi une figure de « roi philosophe » — un souverain guidé par une autorité morale supérieure, fondée sur la sagesse divine.
C’est ce qui lui valut reconnaissance et légitimité après cet épisode de l’eau du puits de Bethléem qu’il refusa finalement de boire. Il voulut gouverner selon les valeurs du Sanhédrin.
C’est précisément pour éviter les abus de ce pouvoir exceptionnel que la Torah impose au roi un ensemble de commandements uniques. Dès qu’il accède au trône, il doit écrire de sa main un rouleau de la Torah, qu’il conservera constamment avec lui, et dans lequel il lira chaque jour de sa vie. Ce n’est pas un simple rituel, mais une discipline quotidienne pour l’ancrer dans les valeurs de justice, d’humilité et de fidélité à Dieu. La Torah insiste : ce rappel constant doit empêcher le roi de s’enorgueillir, de se croire au-dessus du peuple, ou de détourner la loi à son avantage. Ainsi, même s’il détient un pouvoir exécutif exceptionnel, la Torah lui intime de rester en permanence connecté à la loi morale, incarnée par le Sanhédrin. David, en choisissant volontairement de se soumettre à cette autorité malgré la liberté que lui accordait son statut royal, représente l’aboutissement de cette tension : non pas un roi qui limite simplement ses excès, mais un roi qui fait de la Torah la source même de sa souveraineté. C’est cette fusion entre autorité politique et sagesse morale qui donne à son règne une dimension intemporelle.
Sans superposer les époques, le passage talmudique rappelle subtilement l’idéal d’un pouvoir conscient de sa force et capable de s’en remettre à une autorité morale supérieure. Mais ce parallèle trouve vite ses limites. Car dans le cas du roi David, il y avait danger de mort avéré, et pourtant, il choisit de consulter le Sanhédrin, par piété, là où la loi lui permettait d’agir seul. Cette retenue contraste avec les tensions actuelles entre institutions. D’un côté, un pouvoir exécutif confronté à des choix critiques en temps de guerre ; de l’autre, une Cour suprême érigée en contre-pouvoir, parfois elle-même contestée. Dans ce climat de défiance croisée, la morale devient un instrument parmi d’autres dans une lutte de pouvoir. Reste à chacun, non pas de choisir un camp, mais de mesurer combien l’idéal biblique d’un pouvoir enraciné dans l’éthique reste encore, dans notre réalité, à reconstruire.