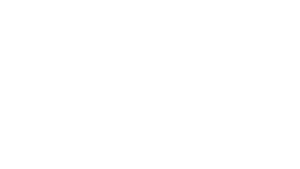Entre la critique biblique allemande qui s’est employée à délégitimer le texte biblique et les tentatives de réécriture de l’histoire des civilisations antiques par les historiens ou par les savants de l’Antiquité, on a vu se développer une remise en cause du narratif de la Torah, construite sur le sable mouvant des datations approximatives de l’histoire antique.
A-t-on des traces de l’esclavage des Hébreux dans l’Histoire ? La réponse dépend de l’interlocuteur.
Le papyrus de Brooklyn
Conservé au Brooklyn Museum de New York, daté du règne de Sébekhotep III (fin du Moyen-Empire, vers 1740 avant notre ère environ), ce papyrus, précieux pour les égyptologues en vertu des nombreuses informations qu’il fournit sur l’époque, établit notamment une liste d’une centaine d’esclaves devant être déplacés. La moitié d’entre eux portent des noms sémitiques, comme par exemple Mena’hem ou Acher. D’autres portent des noms égyptiens, proches des significations que donnaient les Hébreux : Haiimi (qui signifie « où est mon père ? » en égyptien), Hiabi-ilu (également traduit par « où est mon père ? »), Abi (encore pour « mon père »), Shepra, Aduna (c’est-à-dire « mon seigneur »), Aqaba (à rapprocher de Jacob) et Yun-er-Tan (qui peut signifier « peut-on rentrer au pays ? »).
Le statut de ces esclaves étrangers présente quelques similitudes avec celui de Yossef lorsqu’il était lui-même esclave. Plusieurs esclaves portent le titre de « serviteurs sur la maison » (hry-per), qui correspond au rang de Yossef lorsqu’il est employé par Potiphar. Souvent, les esclaves étaient également dotés d’un deuxième nom égyptien, comme ce fut le cas pour Yossef, surnommé Tsafnath Panéa’h par Pharaon.
Ce papyrus, comme de nombreux textes égyptiens antiques, corrobore le récit biblique sur un point qui fait l’unanimité aujourd’hui : une population d’esclaves, apparentée aux Hébreux du récit biblique, a bel et bien été présente en Égypte.
Cependant, sa datation doit être interrogée. En effet, la datation des civilisations antiques a été construite en grande partie sur la base de la datation de l’Égypte antique.
Donnons alors la parole à Diodore de Sicile, historien grec du Ier siècle avant notre ère, contemporain de Jules César et d’Auguste : « Suivant leur mythologie, quelques Égyptiens prétendent qu’en premier lieu, les dieux et les héros régnèrent sur l’Égypte pendant un espace-temps qu’ils n’estiment pas beaucoup au-dessous de 18000 ans, et que le dernier des dieux qui fût roi est Horus, fils d’Isis. Depuis, le pays est gouverné par des hommes qui régnèrent un peu moins de 5000 ans, jusqu’à la 180e Olympiade (60 ans avant notre ère). »
Or cette légende est reprise par Manéthon, qui vivait 13 siècles après l’épisode de la délivrance des Hébreux, telle qu’elle est racontée dans la Bible. Manéthon était un prêtre égyptien farouchement hostile aux Juifs. Il a vécu trois siècles avant notre ère. On sait qu’il a construit son récit sur une datation totalement approximative de l’histoire égyptienne. Or Manéthon est la principale source des égyptologues concernant la datation des antiquités égyptiennes…
Dès lors, nous ne pouvons que confronter deux sources concernant le récit biblique : la Torah et Manéthon.
La Torah est un texte transmis de génération en génération depuis plus de 33 siècles. Il relate la délivrance vécue par des millions d’humains, qui ont eux-mêmes raconté à des millions de descendants les miracles dont ils ont été les témoins et les acteurs ! En face, on trouve un prêtre égyptien qui s’appuie sur des légendes pour retracer l’histoire de la civilisation égyptienne antique.
La délivrance du peuple d’Israël et les dix plaies d’Égypte
Le papyrus d’Ipouir
Le papyrus du scribe Ipouwer raconte la même catastrophe que celle décrite dans le livre de Chemoth/l’Exode. Ce papyrus d’Ipouir est actuellement conservé au Musée des antiquités de Leyde, en Hollande, sous la référence 344 (recto).
Découvert près de Memphis, en Égypte, au début du 19e siècle, il a été traduit en 1909 par un grand égyptologue anglais, Sir Alan Henderson Gardiner, spécialiste de l’écriture hiératique. En effet, le texte de ce papyrus est écrit en cursive égyptienne antique, appelée aussi hiératique, une écriture dérivée des hiéroglyphes sculptés dans les monuments de l’Égypte antique.
Ce papyrus, daté de la XIXe dynastie (pendant le Nouvel Empire), est une lamentation qui déplore le fait que les esclaves abandonnent leurs maîtres et se rebellent. Il décrit de violents cataclysmes en Égypte : le Nil changé en sang, la famine, la sécheresse, la fuite d’esclaves emportant les richesses des Égyptiens, et la mort ravageant tout le pays. Écrit par le scribe Ipouwer, ce papyrus semble être le récit d’un témoin oculaire d’une terrible catastrophe qui s’est abattue sur le royaume d’Égypte.
Comment établir que le récit des catastrophes qui frappent l’Égypte correspond au récit biblique, du point de vue de la concordance des dates ? Si l’on suit les méthodes de datation égyptienne, on le décalera de deux à trois siècles par rapport au récit biblique. Or nous avons vu que cette datation est fortement sujette à caution. Par contre, si l’on suit la chronologie biblique, qui sert de base aux recherches archéologiques au Moyen-Orient, on peut dater les événements relatés aux alentours du 12e/13e siècle avant notre ère, ce qui corrobore le récit de la Torah. C’est la piste choisie par le Pr Vélikovski (1895-1979), qui expose sa théorie dans un ouvrage, bien sûr contesté, mais malgré tout incontournable : Le désordre des siècles. Il explique que la datation de l’histoire de l’Égypte antique repose essentiellement sur la datation relative. L’étoile d’Orion passait dans le ciel égyptien à intervalle régulier de 18 siècles. Dans les bornes de cet espace-temps, les égyptologues plaçaient différentes dynasties pharaoniques. On comprend, là encore, le caractère aléatoire de cette datation. On sait également que Manéthon a inventé des dynasties pharaoniques pour asseoir ses thèses concernant l’histoire de son pays. On est donc, là encore, en face d’un narratif mal daté, difficile à prouver et qui, malgré tout, servira de base de travail à de nombreux égyptologues.
Il ne nous reste qu’à comparer les écrits du papyrus d’Ipouir avec ceux du livre de l’Exode, pour constater qu’une fois de plus, les historiens ont une regrettable tendance à rejeter la Bible quand leurs recherches les laissent dans l’incertitude. Pour notre part, forts d’une transmission intergénérationnelle, nous gardons le récit de la Torah et rendons la pelle aux archéologues.
À la lecture de ce témoignage, l’homme de foi se pose la question de savoir s’il a besoin de preuves. Il peut aussi penser que si l’histoire lui en fournit, il aurait bien tort de les ignorer. La foi est-elle de l’ordre de la mystique ou de la raison ? Maïmonide, (Lois des fondements de la Torah 8, §1) nous assure que les enfants d’Israël ne se contentaient pas de miracles pour croire en la prophétie de Moïse. Ils voulaient, nous écrit-il, assister à la rencontre entre Moïse et D., être les témoins de ce dialogue, pour en rapporter la véracité et l’authenticité à leurs enfants, petits-enfants et descendants. Nous détenons donc ici un témoignage-clé. Prenons-le pour ce qu’il est : un éclairage « en direct » sur une histoire racontée depuis plus de 33 siècles, par des millions de parents à des millions d’enfants.